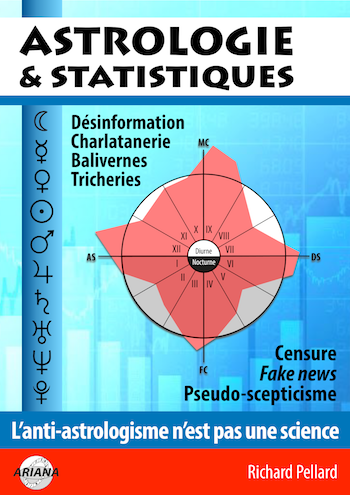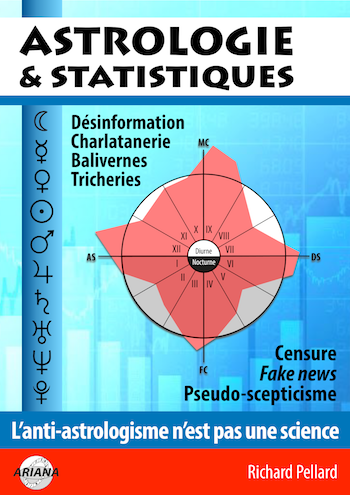Un grand cabanon de deux pièces jouxtait l’étable où les bêtes dormaient la nuit avec les chiens. Georges, un berger du Vercors, partait à l’aube avec ses brebis pour revenir deux ou trois jours plus tard, me laissant avec celles blessées aux pattes. J’en assumais donc la garde et la surveillance. Elles venaient à côté de moi, sous les sapins, se mettre à l’ombre.
Mon seul repère était la lumière solaire. Dès le crépuscule, l’ouïe remplaçait la vision rétinienne par le tintement des clochettes des troupeaux répandus sur les plateaux.
II n’y eut point d’interruption dans cette féerie écologique. La veille se prolongeait par le sommeil dans une embellie onirique où des mondes gigognes se combinaient. Je me suis balancé à tâtons dans cette zone de rêves et de veilles, les yeux grands ouverts sur mes eaux originelles, dans un clair d’étoiles. J’ai saisi enfin la surface et les nappes phréatiques de ma vie. Maintenant je sais que nous ne sommes pas nés et nous ne sommes pas mortels : existence et mort, dissolution et devenir ne sont que des aspects d’une même réalité au-delà d’un perpétuel changement à travers les formes et phénomènes du monde manifesté…
***
Je me suis assis sur le banc de bois contre la cabane et j’écoute. Non pas que j’écoute moi-même. J’écoute, comme je vois, au dehors. Plus encore qu’écouter, je suis en attente, le corps ouvert et tendu aux écoutes de tous mes sens alertés. Très simplement, je suis là, et demeure dans le silence au bord de la nuit. Je suis seul, si l’on veut, mais c’est à ce moment même que l’immense vision du monde se lève et s’offre à mes yeux. Sans que je l’appelle. Car elle est toujours là, démasquée et pure.
Et moi-même je suis paisible comme les calcaires qui sont force et douceur. Cette paix et cet abandon ne sont pas le privilège d’un émoi intérieur, ni les fruits de quelque méditation. Ils me viennent de cette herbe froissée par le vent, de ces picotements de la lumière nocturne sur les cimes, de cette sagesse des choses et du silence de la montagne. Sans doute, les végétaux, les minéraux et les bêtes reçoivent-ils de ma présence en ces lieux ce même sentiment de n’être rien qu’un peu de paysage vivant. Cette sérénité fait partie de la nuit dont elle est la respiration. Semblable aux bercements de l’océan, continus, monotones, elle se déverse autour de moi avec régularité. Et je suis à me demander si ce bruissement innombrable et tranquille est l’expression du silence ou la voix de mon sang dans mes oreilles.
Je ne suis rien d’autre dans cette solitude que repos, le long de mon corps. Je ne me confonds pas avec cette montagne, mais nous nous confondons l’un l’autre à un même niveau d’indifférence heureuse et pacifique. Je n’ai pas quêté, ni trouvé cet ordre calme des choses. Ce n’est pas une présence en moi, celle que l’on appelle la nature. Car je suis moi-même fragment de cette nature ou elle-même. Je suis cette tranquillité des alpages en personne. Il n’y a pas un jeu d’illusionnisme entre les choses, les créatures et moi. Je ne mets pas plus de moi-même que de l’univers dans ces instants qui se déploient autour de moi. Il n’y a rien d’intérieur que je traduise ici, un coin de moi retourne au dehors. Les pentes, les vallées, les plantes, les plaines du torrent, sont à la même tension que moi-même et de ce qui m’émeut. Je ne pressens rien au-delà de ce repos, et je ne m’aime pas dans la nature.
Le minéral, le végétal et l’animal ne m’ont pas appris à me quitter, ni à abandonner le monde pour le rejoindre par les figures de contemplation. Il n’y a pas liaison entre les lignes et les formes du monde et mon destin étendu sur eux, miré en eux. Tout est clair et calme sur la Terre, comme le cri net de l’aigle. Tout est simple aussi comme une abeille qui relie les fleurs à la ruche, le ciel au sol.
II n’y a pas de pensée en moi, pas plus qu’il n’y a de pensée dans la création. Penser, c’est sans doute souffrir, jouir, vouloir, agir, créer. Pas de délire intellectuel qui classe et épuise ma passion de vivre, qui passe au-dessus de l’être vrai. Ma pensée n’est pas en querelle avec l’univers. Je ne suis pas poussé par un impérieux besoin d’imposer au monde extérieur la forme de ma vie secrète, ni d’en faire l’image de mes conflits.
***
C’est par le silence que je pénètre dans la féerie comme par un porche. Mes sens sont silencieux. Mon cerveau est silencieux. Mes désirs sont silencieux. Et ainsi, je sens et je comprends la féerie et la possède d’amour. Car c’est ici le domaine du silence. Un silence compact qui a sa saveur et comme son style particulier. Il règne même là où le tonnerre du torrent imite pêle-mêle tous les bruits que fait l’eau en mouvement. Il réside même de mélèze a mélèze, entre leurs branches qui se balancent. Je suis parfois tiré par sa présence alors que je m’y attends le moins. Comme s’il voulait se rappeler à moi. Un heurt le déshabille. Il me gênerait si je n’étais pas habitué à lui. Un cristal qui résonne au moindre frôlement. Si je tousse, si un oiseau saute d’un arbuste à un autre, tout de suite ces bruits prennent une ampleur démesurée d’énorme fracas. Et j’ai toujours l’impression que ce silence pourrait s’écrouler, d’un coup, si l’on parlait à voix haute ; j’ai alors toujours envie de marcher sur la pointe des pieds de crainte de réveiller quelqu’un ou de déranger les puissances de la création au travail.
Et, cependant, ce calme immense n’est pas si vide puisque j’y convoque toutes les voix des hommes.
***
Silence volant des plateaux, il est ce qui sans doute crée les mondes. Je l’entends, ici, qui agit son agitation suprême dans l’immobilité apparente des choses ! II est comme la source de la nuit qui se dévide autour de moi, le principe au fond duquel j’ai conquis une paix sans limites. Fixité de cette nuit et pourtant quel pouvoir la gonfle et qui baratte son lait d’étoiles ! Quel vide que ce silence ! Comme le creux d’une conque et pourtant quelle rumeur s’y répercute ! Dans cette massivité des ténèbres, le silence qui plane est d’une force joyeuse. Dans ce vide qui m’enserre, j’entends les charges de la puissance créatrice qui font vrombir leurs pales, comme le vide d’une immense roue qui vire autour de son moyeu et de ses rais et qui emplit le silence d’une palpitation infinie dans laquelle s’organise, de spire en spire, la féerie universelle, la fable innombrable, d’être en être.
Le silence des plateaux se confond avec celui de mon esprit, avec cette musique du silence qui me traverse de part en part et qui se résout dans l’ineffable effacement de ce que je suis. C’est un état qui me conduit toujours à une aube calme. Compagnon de ma vie, il est un mode de mon cœur, un verbe extérieur. Il ne tranche rien, car il n’y a rien à trancher, ni antinomies, ni problèmes. Je suis là, dénoué, Iibre et franc comme la paume de ma main. J’ai fait vœu de silence. Et j’ai la sérénité de la vie, de la mort ou de la pierre, dans mon être, une absence Iibre de présence.
***
Subitement, s’étend une autre couche de silence sur l’immense silence montagnard. Il s’abaisse, il monte sourdement. À travers son épaisseur, les arbres parlent, les pentes parlent, les bêtes parlent. Par-dessus le pourtour des cimes, passent de grosses étoiles qui font chavirer le plateau du ciel et tournent lentement sur elles-mêmes. Les arêtes des rochers ondulent et se découpent sur une lueur pâle. Les forêts émergent de l’ombre, ombres plus appuyées comme des îles de velours flottantes. Des collines rondes prennent le guet, là-bas, vers le sud. Le silence coule à travers ma vie ; tranquille, il court dans ma chair et bat comme une grande veine bleue. Et les vallées en sont pleines jusqu’à ras bord. Cette cabane du Vercors m’a appris à parler peu, à faire tenir l’essentiel dans peu. Car j’ai fait silence en moi pour percevoir la voix du monde — non la mienne — et laisser retentir le chant des choses. La montagne, c’est une réduction à l’essentiel. Elle-même n’est faite que pour ses cimes et pour ses hauts gagnages, pour l’aire proche de l’ampleur du ciel et l’étendue du vent. Il n’y a rien sur les pics que la roche et des touffes d’herbe frissonnantes, plus rien que l’élémentaire silence qui tombe de l’éther, qui s’élève des masses pierreuses. Devant le découvert des vallées, on ne dit rien, on se médite avec le torrent, le choucas qui passe, avec les plantes et qui ne parlent pas.
Je tire de la montagne une certitude grande et cette certitude ne s’explique pas. Elle se tait et se suffit, comme la montagne. Car il y a en elle de la hardiesse, une absence de complexités, et de doutes, tournée qu’elle est vers sa destinée avec la forêt, la lande, les filets d’eau, les bêtes qui vivent d’elle en simplicité, comme moi qui ai reconnu son empire. Le silence me nourrit dans cette solitude. Il donne puissance à ma pensée comme a mes muscles. Jusqu’à l’extrémité de mes parois, s’allonge le silence, comme un vide, sans lassitude ni mirages.
Tout est dans le silence du monde, liens à nouer, inextricable écheveau de liens. Aller vers les autres, parler en silence et obtenir des réponses. La vie se meut dans ces échanges muets, dans cette circulation respirante qui donne et qui reçoit. Etre le silence n’est pas renoncement, s’il fait taire les vacarmes qui pourraient encore agiter l’éternel bavardage de mon moi. Il est le souverain qui fait place nette pour la conquête du monde. Il n’est pas dans le perfectionnement du dedans, il est dans ces pauses de la musique, ces interruptions momentanées, pour que l’on entende mieux la mélodie, pour qu’elle reparte mieux aussi ; mais la mélodie, en fait, est continue, elle se poursuit dans les oreilles, bien qu’elle ne se fasse plus entendre, elle est dans le silence, captive et libre à la fois.
La parole me prive d’être attentif aux enseignements des choses, elle m’étourdit. Elle me diminue aussi et soutire ma substance. Ce n’est pas par ce silence que flamboie la vie intérieure avec plus d’éclat, au contraire, il me projette entièrement vers le plein du monde comme la fleur du tournesol gravite autour de la marche du soleil, au sommet de sa tige immobile. Mais cette absence d’élocution m’entretient dans la parole de l’univers que j’écoute avec tout mon être. Mon être ainsi, silencieusement, est mieux l’être du monde et sa joie.
Le vrai silence commence au delà du silence habituel, comme l’amour vrai à celui que l’on nomme. Et les paroles qui naissent du silence, comme jaillissantes du bord de ma chair, s’inscrivent avec une telle authenticité dans la mémoire des êtres, se répercutent tant en eux, qu’elles sont actes et forces avant d’être paroles. Et, néanmoins, comment les redire, comment les rassembler et là, devant vous, les forcer à quitter leur nudité pour se revêtir de ce fatras de signes et de sons qui puissent se communiquer ?
Ce n’est rien, en somme, ce silence, que ma vie étalée dans l’air que je respire, droite et saine, comme elle se trouve joyeuse et aimante, et que n’importe quel regard pose sur elle surprend sans secrets, ni épaisseur, parce que rien n’est caché en elle et autour d’elle. Mon silence attire le silence des autres, tous les silences, et il fait alors si jour dans cette reconnaissance silencieuse, si soleil, que les ombres qui nous accompagnent et nous masquent parfois se trouvent anéanties autour de nous.
***
Ainsi, je n’ai pas défini le silence. Il demeure ce qu’il est dans la vie de chaque jour, à la hauteur de mes démarches, de mes conquêtes et de mes joies. Mais c’est là encore le définir. Ne suffit-il pas que je me repose en lui, que je me sente bien au fond de lui, dans sa présence ? La Terre parle-t-elle parce que le Soleil bouge ? Le ciel parle-t-il ? Dès qu’interviennent les mots, il y a absence et comme une mort. J’ai cependant gagné de connaître les langages les plus secrets, pour être compréhensif avec la pierre, le pédoncule de la feuille, l’élytre de L’insecte, le regard des bêtes, le sourire des hommes, les éclairs de L’eau. Un langage du silence. Et toute chose, créée pour me parler, n’a-t-elle pas emprunté aussi mon propre langage ? Un langage du silence.
II s’agit, avant tout, de faire silence à tout raisonnement et que ce ne soit pas là une aventure. Il s’agit de m’offrir en candeur non recherchée par quelque alchimie mais par les pentes ruisselantes de mon être voué à cette action, comme les yeux à voir. Et non pas par admiration de moi-même. Une exigence de chaque instant, délivrée en spontanéité. Toujours se trouver dans cette disponibilité de prendre part et que cette part soit partagée dans son étincellement dont je ne suis pas le maître, sans tricher avec autrui.
Ce silence est un émerveillement non du haut de moi-même, mais qui part des choses et des créatures en lequel elles se retrouvent par un identique émerveillement ; ainsi, la féerie de la réalité est insérée en nous et se transmet par chaque parcelle de notre vie. Elle est accrochée à l’accomplissement chaque jour de la plus belle joie, de la plus grande possession d’amour.
Atteindre de la sorte, par tous les sens, la totalité de l’être, dans une silencieuse alliance, avec l’espoir et la foi en chacun de mes sens, c’est me trouver en plénitude avec les rythmes qui animent la circulation de toute vie. Parce que je suis moi-même enlacé par les mille bras de la vie, renversé dans leur amour. Et, en me taisant, mon corps embaumé par ce silence, je ne suis pas moins agissant pour mériter d’être imprimé dans la mœlle joyeuse du monde, comme si cette mœlle giclait de moi-même, son créateur.
Ce n’est pas par la vue du dedans, par l’œil intérieur, que j’impose silence à mon être. Ce n’est pas non plus la beauté surnaturelle cachée qui me hante. Ce sont les visions de mes yeux de chair, l’éclat des images reflétées sur l’eau des apparences, la grâce des formes, les réalités incomparables, toutes les réalités, toutes les ombres, toutes les traces du monde qui me deviennent perméables avec mes regards d’homme, ces regards qui pompent le miel des choses, pénétrant et pénétrés.
Ma pureté imite la pureté de l’univers dans ses flammes, ses azurs, ses eaux, afin que notre fusion entière, notre explosion dans l’amour soient une naissance. Car mon corps est le seul lieu où se donnent rendez-vous les créatures. C’est lui qui appelle ses semblables à le rejoindre et il les rejoint aussi dans leurs formes adorables. Il est la tige verdoyante sur laquelle repose le monde. Matière lucide, traversée de soleil, comme mes regards, il voit par tous ses pores. Mon corps est rythme, le propre rythme de l’univers auquel il est sans cesse accordé, qu’il appelle, comme l’espérance appelle l’espérance, par les paroles du silence !
À cause des choses elles-mêmes
Toutes choses, aussitôt que sur elles mes regards se posent, prennent une importance extraordinaire. Non pas à cause de mes regards. Mais à cause des choses elles-mêmes et de la vision qu’elles projettent, de leur présence unique. La vue de ce qui est, dans son entièreté, de quelle béatitude ne remplit-elle pas la terre et moi-même ?
Je projette des étincelles imagées qui ne sont pas des figures que j’ai créées ni auxquelles je serais confondu, et qui ne sont pas moi-même. Elles sortent de moi comme les roses des buissons. Mes visions ne m’appartiennent pas. Elles me sont déléguées. Elles traversent mon corps, comme les sèves les veines d’un arbre. C’est le génie du monde qui s’exprime dans ces images, et non pas moi qui ne suis rien. Je ne suis pas sujet, je suis le médiateur à travers qui le monde fête sa grandeur et sa transfiguration dans les apparences.
Ces images du dehors qui palpent ma vie, qui la tirent vers elles, je me soumets à leurs attouchements, émerveillé à la fois dans mes oreilles, mes yeux, mes narines, et ma chair. Je ne suis que vision, que frôlis de reflets pêle-mêle, goûtant aux multiples formes de la création. Je suis un porte-graines à images. Les images se détachent de mon corps comme ces duvets végétaux qui quittent leurs ovaires et naviguent dans le vent pour les futures nativités florales.
Je suis ensemencé par mes regards, partis pour de longues explorations, chargés de symboles et de puissances allusives qu’ils découpent dans la glaise des réalités et qui reviennent ensuite pour que la circulation des songes dans mon sang imite celle des eaux dans les artères de la Terre !
Infatigables, ils vont. Toujours rassasiant mon corps. Qu’ils se ferment, et mon être n’est pas long à entrer en sommeil avec le grand vide au milieu de lui ou la tâtonnante obscurité le retient comme de la glu. Ma vie a reçu depuis son aube cet apprentissage de l’univers visuel, en s’exerçant à découvrir et à décomposer les formes et les mouvements, les couleurs et la lumière. Par la vertu de mes regards, j’ai reconnu dans la changeante complexité des reflets, une réalité solide, bien définie, celle des volumes stables. La féerie créatrice est déduite du monde des formes, de l’univers des surfaces, grâce aux données que leur octroie ma vision. Que la création perde le gonflement de ses volumes, la flexibilité de ses lignes, sa géométrie, et l’existence lui est retirée.
Les choses sont, parce que j’ouvre les yeux. Mes yeux sont des avant-postes qui reçoivent les images des choses et les enregistrent.
Si j’existe, c’est parce que j’ai des yeux : je vois, donc je pense.
***
Sous la douce coque de mes paupières, mes yeux se déploient dans la clarté comme des algues dans l’océan. Magnifiques palpes de lumière qui se détendent et se contractent autour du monde, ils m’inondent de vertige, ils modèlent mon cœur sur les rythmes des apparences. Ils sont de moi au monde en reconnaissance, ils virevoltent dans l’espace, miment, dansent. Ils sont toujours en jeu. Au-delà de l’amour de mes yeux, commence le territoire sophistiqué des terreurs, des inquiétudes, et du silence.
Vision, accord de mes regards et des reflets qui est l’accord sur quoi demeure stable, dans ses girations, l’univers ! Beauté en chaque molécule de ces apparences, livrée à ma vue, sans conflits, sans refus, beauté qui est la vie de l’amour ! Douceur de mes yeux qui s’apprivoisent au contact de ce velours a métamorphoses qui engaine la création, parce que celle-ci a aussi ses regards posés sur moi, qui me quêtent comme les miens la quêtent en une queste émerveillée ! Rien qu’à dilater mes pupilles, il me prend une faim d’être, une faim heureuse de savourer les parcelles de la vie. J’ouvre les yeux, je crée et recrée le monde, perpétuel miracle !
Ce liseron qui ourle le bord du talus, rosé à peine dans de la nacre, mon regard en a façonné la légèreté et trituré les couleurs. Cette pulpe de feuille, cette substance de roche, qui en a malaxé le grain, étiré le tissu, sinon mon regard, créateur de la matière des choses ? Faculté pure et redoutable de ma vue ! Comme les poissons et les reptiles, elle est ignorante d’elle-même, frottée d’une puissance tranquille. Elle arrache les apparences et s’en revêt, irréelle et vierge, elle dénude l’univers ou lui restitue son chargement d’imageries. Maîtresse d’elle comme de la vie, elle m’octroie ma liberté. Avec elle je marche, indestructible, débloqué, sans duperies. Les choses, grâce à elle, ne se distinguent pas de moi, ne s’opposent pas a moi. Et je me déchiffre fidèlement dans les apparences que mes yeux ont le pouvoir d’ordonner, plus vifs que des couleuvres, plus fermes que des collines. Je sais bien qu’ils les cueillent sur les chemins du monde, qu’ils les façonnent et les tressent.
Si j’ai une pensée, elle vient de mes regards toujours dardés, en aiguilles aimantées, toujours en belle activité ! Ma pensée est visuelle, elle est d’images. Que s’abaissent mes paupières, que s’éteigne le feu de mes prunelles, et je perds le monde, le monde est escamoté et ma pensée se gèle. Puissance de mes regards ! Derrière eux, vient le cortège admirable de leurs serviteurs, leur suite, les autres sens. Mais avant tout s’imposent mes yeux qui savent contrôler, qui savent compléter. Ainsi le monde est le fief de mes yeux, et mes yeux sont le fief du monde.
***
Mon intelligence, cette banque d’images, est d’abord celle de mes regards. Elle tient a cette activité visuelle, à ces habitudes visuelles, par quoi elle peut étreindre les certitudes, les évidences qui illuminent les choses réelles, la force carrée des formes, des vibrations des atomes autant que l’immensité du monde des astres et de mes artères. Partout où mes instincts se déplacent, ils ont pour fourriers la majesté de mes yeux qui les précèdent et leur ouvrent la voie, celle de l’espace, de l’équilibre, de l’étendue, de la lumière. La conception que je me fais du monde, elle est celle qui s’est lentement sécrétée au fond de mes iris, dans leurs lentilles qui savent ravir la vérité des apparences.
Par ma vision, je contrôle l’univers, comme je contrôle les moindres mouvements de mon corps. Ma main se dirige au gré de ma volonté, mais ma volonté est guidée par mes yeux. Association perpétuelle de l’impulsion de mon être qui fait agir mes membres et de mon regard qui suit, dirige, enregistre les variations des lignes, me met en contact avec la totalité de ce qui est, me permet de manipuler et d’observer la matière ! Parois émaillées d’images, de formes en relief, parfois qui jettent des figures, subtiles inflexions des formes, constantes indications des modelés, volumes pleins qui saillent en ronde-bosse sur les plans du monde ! Dures arêtes des contours, fuite des lignes tournantes ! Plastique de la création que ma vue habite. Vision réfléchie de ce qui m’environne !
***
Mes yeux possèdent une notion hardie de l’univers. lis scrutent les volontés de la matière et le sens des formes, mesurent l’espace, étudient le dessin de la profondeur. Dans mon champ visuel, l’équilibre des forces et de leurs jeux passe et repasse avec la souplesse des formes et la pesanteur des volumes ! Matière décorative, voluptés visuelles, prismes de reflets et jeux de couleurs sur les surfaces délectables de mes yeux, ces deux touffes de fleurs noires dans mon visage !
Cette adhérence magique de mon regard qui ne parvient pas à se détacher de la nature, qui s’y enracine, en organe puisant là sa nourriture ! Curiosité et sympathie de ma vue qui arrachent, bribe par bribe, les secrets du monde ! Et aussi, étonnement perpétuel de ma vue, à la fois stable, calme, sans inquiétude, sans transes.
Je vis les yeux grand ouverts, et mes yeux sont en amour avec le monde. Mes yeux, et non pas mon âme !
Prodigieuse image que celle de mon œil nu, braqué sur la création, avec l’amande de son cristallin et sa lentille étincelante, disque de diamant lucide, au fronton de mon corps — morceau d’étoile, rosace épanouie, où vivent les figures et les métaphores, où s’ordonnent les rapports et les dimensions !
Incarné à chaque instant
Je suis incarné à chaque instant. Je suis le réceptacle et la création l’est aussi. Nous nous recevons mutuellement comme la coupe reçoit le vin, et le vin épouse la coupe.
***
II n’y a qu’une seule substance de vie en perpétuité. Nous nous percevons, nous nous incorporons. Le moi de la Terre est mon moi, et son souffle est mon souffle ; c’est le don que se font les amants lorsqu’ils se possèdent dans leur corps sonnant de lumière, d’ou ils renaissent pour se donner et se recevoir. Comblés nous le sommes, par la demande et l’offre, par la poursuite et la soumission, par le “oui” de tous ceux qui renaissent d’eux-mêmes.
Je suis l’amant redevenu vierge pour me livrer encore et encore à ma passion d’amant, et pour en ressortir vierge, encore et encore. Et la création aussi, épouse bien-aimée, se virginise chaque fois après ses épousailles…
Mon entière présence en amour dans les autres, elle entre et sort, elle vient et part par mes yeux, mes oreilles, mes narines, ma bouche. Elle est, impalpable et cependant solide. Elle est de mon corps entier. Bien plus intime que moi-même puisque du poids de son amour elle s’appuie sur moi et adhère a mon être.
Secret tremblement de la pulpe de ma chair lorsque cette présence la jette en ravissement et en splendeur ! Je vais ainsi d’amour en amour, comme de palier en palier, non pas en hauteur, mais sur le plat de la bonne terre et au niveau des créatures. Transmigration éblouissante où je deviens chaque être et chaque objet que je traverse, comme ils me traversent aussi, en des navigations silencieuses !
Comblé par le guet de mes yeux
Je suis en chaque instant comblé par le guet de mes yeux et la quête de mon cœur, inséré dans la paix de cet instant qui est mon éternité. Mes mains ont sans cesse besoin de se poser, comme d’autres mains sur leur volant, leur tour, leur outil — sur une certitude — et d’être en éveil, vigilantes. L’amour ne peut naître que si l’on est deux. Il est, à l’égal de la vie, une force qui naît par l’acte d’amour.
Je ne suis pas explicable par des états, mais par des démarches et des actes. Je suis acte par mes bras, par l’œuvre de mon corps. La graine gonflée de chaleur et d’humidité démêle toujours sa route à travers les éboulis du sous-sol, vers la lumière. Elle ne germe pas, pointe en dedans, en direction de la nuit souterraine.
Ma conscience est sortie de moi, chassée, pour entrer en camaraderie avec chaque objet et chaque créature. Je suis en tout parce que je suis tout, concentré dans la chaleur et le froid, le plantain et le roc, les veines blanches que fait la neige dans les ravins de la montagne, le vent de l’aube, les bêtes muettes et pensives, à la recherche de l’univers lové dans un grain de sable, à la recherche du grain de sable lové dans l’univers.
II n’y a pas un homme au monde, qui ne soit lié à tous les autres. Et il n’y a pas de formes qui ne soient liées à d’autres formes, à travers la multitude des apparences. Dans la feuille d’arbre, je vois la création, et en celle-ci, je retrouve enclose la structure de l’homme, comme dans chaque goutte de rosée se mire tout le Soleil, et dans chaque pépin se dessine déjà le pommier entier.
Je suis délivré du mystère de mon unité, par ma chair qui est innombrable. Je ne me trouve pas en profondeur mais en surface, dans les diverses directions de ma vie, pacifié, rassasié à ma faim, mais toujours en attente, au bord d’une nouvelle faim. À trop scruter ma conscience, quelle amertume se répandrait dans mes vertèbres, et ce dégoût, et cette orgueilleuse hargne, qui sonneraient faux, qui sentiraient l’huile de lampe avec des pâleurs d’âme qui se voudraient transparaître en pureté ! Rien n’est en-deçà de la portée de ma solitude ; ce qui se trouve le plus au fond de la vie, dans son lointain, est le plus proche de moi. Mon envolée s’ouvre sur le terre-plein du monde et m’y entraîne. Et les traces que je suis n’ont pas été marquées par mes seuls pas, mais par des masses d’hommes en mouvement les uns vers les autres, et vers moi.
***
II n’y a même pas l’épaisseur d’une bulle d’air entre les êtres, lorsqu’on s’est dépêtré de son moi et qu’on a été rebaptisé dans sa pureté de créature de chair et d’instincts. Il n’y a pas d’arête entre un homme et un autre, dès qu’on s’est élargi en simplicité et joie du côté du vaste espace où la vie a déposé ses petitesses et ses grandeurs, en un seul tout. Si c’est la une aventure que je cours avec la solitude, elle n’est pas une glissade en flèche vers moi, mais dans les autres, pour prendre part à leur vie, comme eux à la mienne, au niveau de l’humble existence familière.
Rejoindre la présence du souffle du monde, se tenir en lui, pas seul, surtout pas seul, mais multiplie à l’échelle du grand ensemble, être dans la courbe des destins divers, dans leurs parcours jamais bouclés ! L’empan de sol sous mon corps d’homme, le carreau d’azur qui m’éclaire par le haut, ne me barrent pas la Terre, ni le ciel, mais les contiennent, les perpétuent, et les englobent. Moi de même, avec le reste des créatures, d’identique substance, d’identique vouloir.
Jamais cette solitude n’a pu me faire sentir son poids. Elle n’est qu’une halte au milieu d’autres haltes, et d’elle partent mille orientations vers le grouillement innombrable des êtres et des choses. Elle ne vient pas si vite, pas plus cette sérénité qui est indulgence, qui est aussi chaleur et lucidité d’amitié. C’est un bien qui se paye, qui se conquiert et se donne aussi, non à bon compte, ni à bon marché ! C’est posséder la source en soi qui ne se tarit pas, la vie aimante qui ne se dessèche pas. C’est se rapprocher de ceux qui sont abandonnés dans leur aridité ou leur révolte, et qui ignorent ce royaume transparent où les cœurs se donnent et se voient, c’est entrer, avec la camaraderie au bout des yeux, en ceux qui n’ont pas d’amitié dans leurs regards, et les réveiller à leur joie !
Car il n’est pas d’homme ni de chose qui n’en possède le signe, et c’est là aussi vivre en solitude que d’appeler à elle ceux qui la méconnaissent. Elle ne m’appartient pas, elle doit être le bien général, elle se tient au centre de chacun. Seulement, il en est qui passent à côté d’elle, sans la voir. Je la donne pour qu’on me la rende. Je la rends claire à ceux qui passent aux limites de sa présence pour qu’elle se répande d’esprit en esprit.
L’image de mon destin m’échappe, elle ne se laisse même pas pressentir dans ce qu’on a coutume d’appeler le mystère, elle se tient à mon poing, au seuil de mes regards, et s’accomplit en autrui par la mise en commun de notre fraternité. C’est dans la lumière crue des réalités familières que nous sommes ce que nous sommes, simplement.
Et certes, il demeure que dans les réalités ressenties, il faut qu’interviennent, afin d’ébranler notre paresse, ces heurts magnifiques mais inexprimables, par quoi nous sommes rejetés dans notre courant : un passage d’oiseaux, ou une branche lamée de clarté — un regard de bête ou d’homme, en besoin d’amitié. Mais il n’y a pas ici instincts, et là esprit, ici chair, et là âme, des épaisseurs ou des immaterialités qui démembrent et divisent, quand l’ensemble se tient inextricablement, rebelle à l’analyse, prise totale de l’être retourné au dehors.
Je me découvre de la sorte sur la figure d’autrui comme sur la figure du monde. Je n’ai d’existence propre que par l’existence de milliers et de milliers d’autres qui m’ont reconnu et suscité. Cette réalité de la présence féerique n’est ni mystérieuse, ni impénétrable, bien que poignante dans sa gravité et ses agencements. Elle est ce qu’elle est, la vie, sans qu’on puisse la fixer ni la retenir, pénétrante de chaque côté, libre de commentaires, mais lumineuse à la surface de l’être. Plus de “moi”, plus de l’“autre” : il y a “nous” dans l’entente de nos opposés, dans l’équivalence de nos contrastes. Nous nous répondons, comme l’endroit à l’envers sur une même trame, deux faces complémentaires. Nous nous parfaisons : le monde repose sur cette loi.
La solitude donnée par les choses
La solitude ne m’est pas donnée par moi-même, mais par les choses de la Terre, mes semblables. Les courants que creuse mon sang dans la matière du monde ne me recouvrent pas comme la pluie habille un arbre, mais enserrent les créatures dans les lianes de leur vaste système fluide. Jamais la nuit d’un abîme spirituel ne se découpe en moi. Car je suis posé dans la crudité du jour, comme une main sur une autre main, qui ne pèserait pas plus qu’un peu de lumière franche.
La “passion” du monde se vit au fond de ma chair, en une grande transparence, et ma “passion” d’homme de plein vent se vit dans la chair du monde.
Ce n’est pas exigence de me sacrifier, c’est un état organique, volontaire et involontaire a la fois, où je ne disparais que pour me loger dans les autres.
Je suis greffé sur l’arbre à images, sur la chair à foules de la Terre, et je me décharge en féeries dans la féerie terrestre.
L’églantier à peine délivré de l’hiver, et buissonnant dans le ravin, la semence qui fait craquer la croûte d’argile qui la mêlait aux secrets du sol, la flaque d’eau bleue, le soir, dans une ornière, mes regards viennent sur eux, et tout de suite, ma bouche prononce avec effusion : “Est-ce donc vous ?” et chacun, de me répondre : “C’est nous, et c’est toi aussi.” Acte de reconnaissance et d’alliance, nous sommes ainsi présence indissoluble.
Cette intensité de mon attention, cet intérêt passionné qui me tiennent en éveil devant les vivants, n’est pas rêverie mais attitude logique, car ils me plongent aussi bien dans les choses vulgaires que dans celles à qui l’on a coutume de concéder des titres de noblesse. Rien n’est irréductible, impénétrable. Parce que ma nature n’est ni singulière, ni unique, et qu’aucun objet ne m’est fermé par son opacité. Ma présence est si impérieuse aux choses, et les choses si abandonnées dans l’amplitude de ma vie que la moindre vibration de mes hormones n’est que le contrecoup, le choc, de la vibration indéfinie de l’univers raccordée à mes tissus et à mes sens. Mon âme personnelle, échappée depuis longtemps de ses limites, a restitué ses puissances à la vie cosmique, bue par elle, comme la vie cosmique est bue par moi, en une possession immédiate.
Je suis avec la réalité un seul être comme l’enfant dans le ventre de sa mère, un seul être composé et recomposé par la féerie qui est aussi amour. Jamais “dépaysé”, mais toujours “paysé”, racine dans la vaste saoulerie du terreau universel !
Mes cellules, mes humeurs, mon sang font leur ouvrage sans que j’y intervienne, sans que je prenne garde à eux. Je ne suis qu’une pièce de l’ordre des choses, ni plus ni moins qu’une motte de terre ou qu’une graminée. Je ne puis remplir ma destinée que si je suis à ma place, dans cette “police” du monde des créatures.
Je regarde cette naissance d’eau aux lèvres du rocher, en ses bouillonnements. Elle arrive par continuité, elle se suit et fait alliance dans le secret avec les choses souterraines, elle gagne les substances poreuses qui l’accueillent, et les pentes qui la descendront, palier par palier, des hautes terres jusqu’aux vallées. L’eau n’est pas isolée. Elle fait appel à ses complémentaires qui l’attirent, et qu’elle attire. Il n’est rien qui ne se compense. J’impose par mon souffle un équilibre. Mon existence contribue à susciter un rythme qui participe au maintien de ce qui est.
Miracle constant et nécessaire que cette communauté, régie d’or de l’univers en son intégrité vivante ! Toujours la vie apparaît en un seul bloc, et puisque j’accepte de n’être que ce que je suis, coule dans l’être collectif, avec un destin sans histoire, fiché au cœur du destin de la Terre, je sais mes voisins proches, mes parentages, mes frères les herbages, mes mères les figures du soleil, et ces augustes puissances qui ne cessent de m’enraciner.
L’unité cosmique qui a résorbé les dualismes n’est pas une nébuleuse, n’est pas la mort du sensible, ni le refus du réel. La solitude que je vis est un ordre viril, une passion active où je dis sans cesse “oui” à la destinée humaine. Si mon moi est aboli, il reste que je me dresse au-dessus de ce moi dans l’action, ennemi des ténèbres, et vivant par la vertu de la joie.
Mes yeux sont grands ouverts au cœur de cette immersion, armés d’une seconde vue. L’interne a été happé et pulvérisé par les apparences bienheureuses du dehors dont les figures s’étalent autour de moi et dont la connaissance me plonge dans la destination sans fin des êtres et des choses. Je ne désire accéder à aucune autre réalité qu’à celle qui s’engouffre dans les prises de mon corps, disséminée partout à la surface de la création, et qui est intégrale, temporelle, victorieuse.
Accroché aux nervures de mes veines
Je suis gluant de ma lymphe, à pleine peau, accroché aux nervures de mes veines, la coque de ma substance en lait, avec des gondolements sans contractures dans mes vertèbres, et malléable dans mes songes, en fluidités ténues. Toujours en attente de ma puberté, et pubère en même temps, à travers mes chromosomes affirmant la divine liqueur tirée de ma mœlle, toujours vierge et cependant en actes innombrables d’amour.
À chaque moment, tout m’est neuf, tout commence. La Terre est née, la création s’apprête demain, avec l’aube couleur de joie, à préluder. Je n’ignore rien de mes esquisses nerveusement tremblantes et à peine effleurées, de mes desseins d’approche plus ou moins poussés, resurgis de ce que je suis, toujours en passe de préparation, avec des contacts hésitants, et ce sourd travail de mes lignes qui s’entrelacent, reviennent sur elles-mêmes et se quittent. C’est comme l’irruption de l’esprit dans le sommeil. Je me précise à peine dans mon exécution, je plonge dans mes limbes, tache ténébreuse, revêtue soudain de blancheur, qui à son tour s’éclipse pour s’éprendre d’une autre blancheur.
Je n’ai jamais fini d’être. C’est pourquoi, de part en part, je suis en train, toujours, d’être.
Aucun de mes états n’est mon état. Il faudrait que je puisse me saisir à travers mes millions d’états qui se succèdent, se superposent et se mêlent. Je ne suis pas arrivé à conclusion. Rien n’est conclu en moi, pas plus qu’en ma condition d’homme qui tâche de penser : pensant en mouvements et en méandres, je ne conclus jamais.
Je suis provoqué par d’incalculables touches éparses, et mes “surgies” éphémères répondent aux désirs des forces qui me manipulent, et de la volonté permanente qui me braque. Je suis toujours abandonné dans l’inabouti, perplexe et resplendissant, fugitif et éternel, présent et absent, à mi-chemin entre la vie et la non-vie, genèse d’un être qui se projette, alors qu’un autre se contracte et se résorbe et qui toujours, de sa dernière variante, est le plus dissemblable.
***
Dès que la fente de mes paupières se desserre, les choses, d’un bloc, se frayent passage à travers mes pores. À peine mes membres bougent-ils, empêtrés dans leur formation, encore gourds, le temps d’une contraction, que le feu endormi dans la Terre se délivre et grésille en mes veines qui s’en vont en fleuves bleus sinuer autour des reliefs géologiques du globe…
Ainsi je fluctue au gré des énergies vitales qui me sollicitent. Doucement je vais au branle d’une allure somnolente. Torpeur des animaux, rêverie des plantes, voici des images que j’emprunte pour me dire, mais je suis à la fois le busard, la graminée, le roc et l’homme : un emmêlement indistinct, fait de tiédeur et de pacification, que connaissent aussi les chamois, les rhododendrons et resécrats de silex, parce que je remue dans cette vague existence terrestre qui est bourrée de ressorts terribles et de flamboiements, avec tant de promesses en sourdine dans mes plis…
Je suis l’instinctif, celui qui rit avec ses sens soyeux comme du lait, bouquet d’antennes frémissantes qui prospectent par d’invisibles attouchements les organes du temps et palpent les édifices de la stratosphère.
Ma béatitude est fragmentée et partagée. Je suis le fruit sorti de son écorce, repoussé par les pressions de l’azur, les fluides, des averses solaires, et par les puissances des sphères. J’avance dans l’indifférence d’un destin individuel où l’être se désaccouple de ses origines naïves. À peine façonné, je suis balancé dans une léthargie où retentit la rumeur des êtres et des choses, leurs sourdes aspirations. Pas encore différencié, à mi-chemin entre l’arbre, la terre, la bête et l’homme, je n’ai pas rompu mes attaches avec les domaines du primordial, avec les longes qui me maintiennent en conciliabules parmi les fonds montagneux, les sèves et les choucas.
***
Je suis de vie végétative, et c’est là pour moi un titre d’honneur, comme celui d’être de vie animale. Je suis à la fois et de vie d’homme et de caillou, enfin de vie simplement, qui englobe en elle toutes les vies. Mes os sont les ordres d’agrégation des minéraux, mon sang, les veines de l’eau. Le lac de sang qui baigne mon cœur, c’est la salure de la mer océane. Je suis toujours humide de mes venues au monde, un grand tas de pensées encore sourdes, gonflées de visions utérines, hésitant entre les gemmes et les flores, entre la chair et les écorces, qui germent et se stratifient. Je meurs comme la poussière et je renais arbuste ; je disparais comme arbuste et je deviens choucas ; je meurs choucas et je revis torrent ; je sombre dans la mort et reviens à moi-même. Je suis les atomes du Soleil, les robes d’honneur que revêtent les nuits, les nœuds des racines. Éponge, atoll, hippocampe, que sais-je ! Suant mes phosphores, mes iodes et mes radiations, myope d’avoir été déchiré de mes coutures natales, arraché de mes fluides densités.
Fruit de mer, je le suis, et fruit de terre et fruit de ciel, mon “hommerie” mêlée à ces règnes déroulés à travers mon squelette et ses vêtures de sang, toujours en puissance d’une voie lactée dansante, ou d’une fourrure d’herbages sur les épaules des gibbosités, ou d’un filet d’eau à l’aisselle d’une roche poreuse, rongée de capillaires.
Si je surgissais du bloc de mon chaos, je trahirais mes naissances qui se séparent d’elles-mêmes, dans leur extraordinaire vertu de jeunesse sans fin, endormie, mais toujours en redoutable réveil. Plage lumineuse dans les épaisseurs de mon engendrement, je me dégrafe de ce que je fus pour d’autres plages, léché par les ondes nocturnes, roulé parmi les fonds marins, vers la lueur de ce que je serai. Tout se croise et s’entrecroise, selon des gestes rituels, qui ne se dessinent qu’avec la gratuité du songe. Ma réalité est à la fois lointaine et présente, comme des paroles dont on n’entendrait que les résonances profondes. Je poins à peine, avec mes visages infinis, ma symbolique, mes mystères, puis je m’évapore sans laisser d’empreinte.
***
Mais toujours je garde la mollesse de ma dernière argile, et mes masques hésitent à mes contours, comme on hésite entre la joie, l’angoisse et le doute. L’ouvrier oublie toujours ses derniers coups de ciseaux et me laisse frustré de ma mortelle perfection, pour que darde, bien d’aplomb dans ma mœlle, l’aiguillon des genèses me laboure encore les reins, et que je sois toujours en avant de moi-même, au-delà de mes morts…
Que frétillent à mon ventre des nageoires ; le long de mon derme, que s’animent les reptations luisantes de l’orvet que des rejets rappellent ma noblesse de mélèze ; que la chauve-souris volette entre les deux ailes membraneuses de mes mains ; que je m’allonge dans les feuilletis de schistes.
Ainsi suis-je coulant dans tout ce qui est liquide, se fond et se dissout, les circuits de la vie et de la mort recommencés. Et je ne fais qu’un avec le temps, continuant à flotter et à me fondre sans arrêt, avec la lenteur d’une algue qui se meut.
En un choc continu, léger et pesant à la fois, avec des éclairs et des retombées dans la nuit, je file comme un dauphin dans des nappes profuses et indéterminées, semence à peine levée, vibrante parmi ses évolutions dans l’intimité du sol qui est lumière.
Aveugle comme un chiot à sa naissance, et pourtant quel étincellement je délègue par ma vue à l’univers, enlisé dans les choses, pour juste voir et ne pas voir, pour juste recevoir les reflets des apparences, entre mes cinq doigts écartés, au creux de mes yeux tâtonnants. J’émerge sans cesse de la nuit, tel le feu de la pierre, je romps les charniers de mes membranes gélatineuses, ma chair résorbée dans celle de la Terre, et qui voit par des regards multipliés à l’infini, comme les couleurs dans le prisme. Et j’accrois mes visions qui sont tonnantes de mille et mille tympans délicats, je multiplie la sonorité des voix du monde et leurs échos.
Aucun destin particulier
Je ne suis pas prisonnier du cercle d’un destin particulier, comme la robe en corolle épanouie et tournoyante, au milieu de laquelle, extasié, s’enivre le derviche tourneur. Je ne suis pas inscrit dans la figure d’un dessin au trait, clos à jamais. C’est une dérision que de me soumettre à cette dénudation, qui montrerait de moi, quoi ? Dont les chocs libéreraient quelles puissances ? Je n’ai pas à me décharger de ma boue, ni à reconquérir des puretés perdues, ni à me ressasser de remords et devenir le bourreau de moi-même, pour quels crimes ? Quels péchés ? Je ne me mesure pas en combat singulier avec moi : mon épée ne rencontrerait que son ombre dans cet assaut contre le vide. Cette connaissance gourmande et jalouse de ce que je suis, ces regards ouverts sur mon gouffre, me sont inconnus ; ce serait me chevaucher moi-même, centaure ténébreux.
Voir clair en moi ? Mais mon corps est un bloc de cristal. M’épancher en vastes énumérations passionnées de ce que je suis ? Mais je ne cherche pas à me plaire ni à me complaire, et ne m’édifie pas un moi pour me soulager de mes contradictions. Mon moi n’est pas un milieu privilégié, le milieu du monde, où ne retentit que ma voix. Pas de ce jeu à corps perdu, de cette quête à âme perdue, où je vire, toupie d’orage, dans mon gouffre.
Car il n’est d’autre aventure que celle qui nous est commune, et non la marche vers soi-même où tout perd de son importance qui n’appartient pas au tragique d’une solitude sans issue.
Je ne suis pas acteur et spectateur à la fois dans la tragédie d’un moi, dont je suis absent. Je ne suis pas cette inquiétante statue qui avait le pouvoir de tourner les yeux en dedans. Je suis vue solaire, étincelante et sans ombres, car mon existence est apaisée, elle est née apaisée, dans la paisible présence des choses.
Ma solitude n’est pas intolérable. Elle ne heurte pas dans les ténèbres des récifs d’absurdité.
À fleur de Terre recueillie
La chair de l’univers, cette terre à rocs, à argile, à verdure, avec ses vertèbres qui sont les ordres d’agrégation, avec son sang et sa sève qui sont les veines de l’eau, avec ses respirations qui sont le flux et le reflux de la mer océane, elle s’ouvre à mes organes pour que nous nous prenions L’un l’autre et fassions échange de nous-mêmes.
Aucun désaccord en cela avec la réalité, au contraire il y a liaison permanente. Je suis dans le sensible et le présent, au centre du feu qui s’active dans la création. C’est une vie instante que la mienne et à fleur de terre, qui se recueille en recueillant l’univers, qui est rapatriée dans chaque vie, et non exilée, vie ininterrompue qui éclate à chaque moment, avec cet étonnement devant sa permanence, toujours neuve à mes yeux neufs, éternelle et récente, comme l’amour.
Jamais la vie n’est absente ou refluée dans mon cerveau. Il n’y a pas de vraie ou de fausse vie. Il y a l’amour passionné des choses, des choses rugueuses et dures, réservoir d’images, amour qui va vers autrui et vient en moi — amour du transitoire, du fabuleux transitoire, lourd d’apparences et de symboles — amour qui a la saveur du blé, de la pluie et des flammes, aussi pur que l’ortie et le vent — amour donnable, je le retrouve en tout. Je suis le nouvel Adam en chaque jour et en chaque chose animée et inanimée, qui retrouve sa royauté édénique.
La présence féerique éclate dans mes dix doigts comme des étoiles, dans mes dix orteils comme des étoiles. Je suis constellé de part en part par son courant ; il me relie à la circulation des sphères, au surgissement du Soleil et a son départ, à la couronne de lumière sur les collines, à l’arrondi de l’horizon.
Je sens la création tournoyer. Elle tournoie et c’est le cercle mouvant des Signes du zodiaque qui virent et sont les beaux mois de l’année, les prospères saisons, le long cours des journées et des nuits du temps qui coule comme un fleuve. Chaque Signe, je le suis, le Bélier et le Scorpion, le Taureau et le Poissons. De chaque créature je suis la copie exacte. J’embrasse la substance de l’univers dans mon plasma où s’imprègnent les formes, où se déchargent les forces de l’aigle et les souplesses de l’eau. Mes puissances sont vannées sur l’aire du monde. Je pénètre son poids et sa massivité. Il s’évide, s’allège à mon passage, vogue comme les vapeurs qui montent des vallées. Comme elles, il n’est qu’un songe visible, un fantôme surgi du centre immuable des choses. Mais vite la féerie me mène jusqu’à la naissance et jusqu’au refroidissement des mondes. Par elle, la vie est caillou, et le caillou est vie, l’inorganique brasille de vertus, de tensions, de cohérences, avec les plantes, les bêtes et les humains. La toute-puissance de l’inertie, elle aussi est de l’ordre des sphères en vertiges de feu, en secrètes transmutations, en cycles incessants, comme les chenilles, les fœtus, les germes.
Ces ponts jetés entre les puissances de la vie et moi, — ces puissances qui sont identiques dans le feu, l’eau et la pierre, dans les odeurs et les racines — ils sont d’arcs-en-ciel ou de fils de la Vierge. Je suis engagé dans une marée incessante d’apparitions et de disparitions, comme l’univers entier, depuis les montagnes jusqu’au protiste, cette cellule vivante primitive, engagé dans une transformation perpétuelle comme la source se transforme en rayon énergétique de congélation ou d’ébullition.
***
Je suis le fruit de cette féerie dans ce qu’est la Terre, et si j’ai une pensée, elle est attachée à la surface de cette Terre si bellement visible et pure, comme un œil ou une aile d’oiseau. L’image de la féerie n’est pas immuable, n’est pas simple. Elle est bourrée de forces contraires, celles de la vie et de la mort, qui sortent l’une de l’autre. Mobile, tout est lutte en elle, et des chocs de ces formes adverses, naissent des créations nouvelles, irréductibles aux précédentes, des mutations brusques et instables, qui apparaissent et disparaissent, en abandonnant des créatures neuves, des images fraîches.
Ainsi mes contradictions sont créatrices, elles sont celles qui transforment la vie. Elles sont féerie. La substance du monde est le feu et l’eau, le pour et le contre, les oppositions, les pôles. La mienne aussi. Ma substance est une part de celle du monde. Je suis bruissant de mes incohérences, celles qui modèlent la vie. Je suis tantôt l’endroit, tantôt l’envers de moi-même et des choses. Je suis ici, enté sur des buissons à dards, et là, coulant dans les galeries à taupes. Si la joie est glissée dans mon système de chromosomes, elle me rénovera bientôt d’une houle immense de douleur ou de colère. Je suis la proie de la fatalité des ricochets, des va-et-vient de ce qui se meut et de ce qui respire. Je suis planté en eux, j’adhère à eux, le temps d’une plongée, puis d’une brusque saccade de mes deux talons, je remonte et fais le geste du nageur pour développer mon corps dans l’alchimie aérienne, magique fuseau qui connaît les lois des lévitations.
Je bée par chaque pièce de ma vie sur la rondeur du monde, sur la superficie en courbure de l’air qui flue autour. J’arrache, taie après taie, l’aveuglement de ma vue pour qu’elle se délivre d’elle-même afin d’appréhender l’obscur et ce qui n’est pas obscur. J’écorche, peau après peau, l’épiderme qui me resserre, d’une seule tirée, de haut en bas de mon corps, comme une pelure de fruit, et ainsi je quitte toujours ces pelages, ces membranes, ces écailles, ces pellicules, afin de me répandre comme de l’huile pour les grandes mutations élémentaires, et qu’il y ait justice entre la création et moi. Si je bouillonne à la source des nuits, je suis écartelé par mes cinq membres et ravi par les centaures du soleil, en un supplice suave. Tour à tour, je suis cet homme, et cet autre, tour à tour, le fleuve me happe et me repousse, dans son écoulement.
Où sont mes unités, où mes limites ? Je ruisselle d’antinomies, d’éclatements, de fluides lunaires, de secousses qui émeuvent mon sang, puis s’engloutissent pour reprendre à nouveau leurs fulgurants circuits : en chaque direction de la vie, je suis naissant. Je jaillis, d’une pièce, comme un javelot, comme la pierre d’une fronde, comme un rayon, dans la trajectoire qui me suscite, revêtu de la gloire de la vie, à l’égal des moindres objets qui sont dans cette gloire — giclant comme un jet de lait ou de vin, d’une traite, du haut de moi-même : jarre tranquille, jarre immobile ! Comme la Terre qui cependant vire et pivote dans sa rondeur de bille éteinte, au fond du vide, est immobile, est tranquille ! Mythologies enflammées pour chaque arbre, chaque bête, chaque brin de paille ! Et pour chaque homme, mythologies enflammées qui ne sont ni grecques ni latines, qui me dévorent de joie et de soleil parce qu’elles sont les déesses des apparences, et l’esprit des apparences !
Sans cesse dans ces plongées de mon “hommerie”, dans ma naissance et cette aspiration jamais perdue qui s’abouche à la source de la joie, je goûte ce calme séjour à l’ombre adorable de la création.
Plénitude de mon enfance indéfinie, où je n’ai jamais atteint l’âge de raison, avec les guirlandes des êtres, avec les anneaux des choses autour de moi, dans ce monde qui est un grand piège d’images capturant mes regards, et mes regards qui piègent eux aussi l’univers des images, étonnés d’être devant les figures du monde et de découvrir constamment des objets depuis longtemps familiers.
Article suivant — Une écaille d’ombre