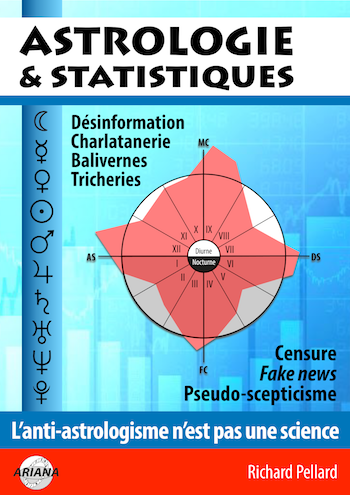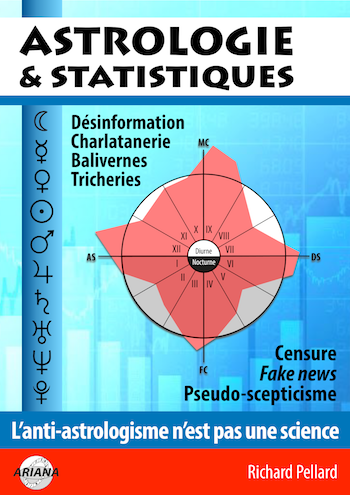Entre toutes les présences, c’est vers celle de l’homme que se dirige mon choix. Elle parle plus que les autres à mon besoin de féerie, et la féerie aussi me parle plus aisément, parce que je suis l’homme qui la connaît.
Des coins les plus reculés de la Terre affluent vers moi les appels des hommes, leurs gestes, leurs accolades.
On est toujours seul et maudit si l’on déserte l’homme.
Aucune vérité n’est valable, sinon atteinte à travers les êtres, et non uniquement à travers moi.
Je ne m’atteins jamais parce que je vais toujours. Je suis ce qui ne s’arrête pas, ce qui ne s’endort pas, dressé pour l’acte de la vie.
C’est dans le renoncement de l’individuel que triomphe l’individu.
Quand je me trouve parmi les autres, mon être s’éclaire de leurs rayons. Loin d’eux, je suis éteint. Je ne puis exister sans participer : mes mains couleur de monde, mes yeux couleur de Terre, sont les fruits de cette participation.
J’ai maintenu avec autrui une amitié charnelle où je goûte la saveur de n’être jamais moi, et où je ne suis que naissance, triomphe, que Diane héroïque au matin, chaque jour d’un monde nouveau qui se lève et se livre à moi.
Mon accomplissement tend à “l’objectivité” de mon être. Je me mets au dehors pour me reconnaître, établissant ainsi un système de relations infinies qui procèdent de la féerie.
Je n’ai aucune conscience d’avoir une individualité distincte de celle des autres, ni ce sens de la séparation qui exaspère l’être.
Je ne célèbre pas mes propres mystères. Je n’exige pas que le monde abdique en ma faveur, réduit qu’il serait aux dimensions de ma personne.
La conduite individuelle est la mort, mais révéler sa dignité à autrui, c’est vivre. Si je défends ma cause, c’est qu’elle ne peut être que celle de mes semblables.
La communion des hommes, je la place au-dessus de mes singularités.
J’accepte d’être la répercussion d’un cri universel, d’être ce cri même.
***
J’ai toujours porté depuis mon enfance, comme une force, l’entente avec moi-même par-dessus mes contradictions, par la joie en chaque chose vivante. Toujours incarné dans l’existence des autres, je ne me distingue pas de tous ces bien-aimés, je ne distingue pas entre eux. Un sabre ne coupe pas, tant qu’il est dans sa gaine, le feu ne se découvre qu’en s’élançant hors de son foyer de cendres.
Je n’aime pas l’homme pour ses idées, mais pour ce qu’il est dans les rencontres de chaque jour, non pas d’un amour suspendu à une attitude spéculative, mais à sa responsabilité propre.
Je sais qu’à chaque interrogation que je lance, se trouve pour moi, quelque part, une réponse, proche ou lointaine. J’attends toujours, je reçois toujours cette réponse.
Si j’abandonnais les remous des hommes, pour n’être qu’un isolé au milieu de la création, je me briserais comme se brisent en éclats les poissons des grandes profondeurs si amenés à la surface de la mer ils ne sont plus protégés par la pression de l’eau qui les empêchait d’éclater.
***
Je suis roulé parmi la rumeur des messages, tant je suis enfoncé dans la vie commune. Jamais une seule dérobade. À chaque instant, j’ai rendez-vous avec l’existence des autres, rendez-vous de lutte ou d’amour, rendez-vous lucide où l’on accepte et refuse, cimente et bâtit.
Nous savons pactiser et faire alliance, non seulement d’homme à homme, mais de chose à chose, de pierre à pierre, de feuille à feuille, de silence à silence, et ainsi nous libérons la nuit, nous disons à la lumière d’être, nous repoussons la vie de ses solitudes, comme les aiguilles des mélèzes tombent, comme les bêtes de leur hibernage sortent…
Jamais ne me cernera ce silence terrible où je me trouverais soudain, si j’étais coupé de mon dialogue avec le monde et avec l’homme.
La solitude est la figuration de la mort. Elle n’est sauvée de cette négation absolue que par la féerie à travers laquelle la création et moi nous nous interpellons sans arrêt par des fraternités rigoureuses qui ont un sens précis et une destination authentique.
Si le rôle de mon destin m’échappe au sein de cette solitaire cabane, j’ignore aussi le rôle des autres. Or, je sais mon rôle ; il m’a été inspiré par la responsabilité de la création envers moi, et par ma responsabilité envers elle. Et je ne vis pas des aventures exceptionnelles dans un paradis d’innocence.
Si je suis, je ne puis être que par le consentement de tous, que par ce qu’ils ont fait de moi.
Prise de possession
Hauts lieux des grands espaces, ces plateaux du Vercors ! Ils sont gonflés de féerie à travers leurs veines et cette féerie se répète en moi avec ses images titanesques. Je suis le confluent de ses forces, une énorme crue qui me traverse. Elle me dépouille de mon enveloppe, et je me dévoile à elle par une prise de possession où nous nous apercevons sans miroirs, et sans pensées, personnes vivantes, être du grand être ! Elle est semblable à une chanteuse dont la voix monte au milieu d’un escalier : ceux qui sont en bas ne la voient pas, non plus que ceux qui sont en haut, cependant son chant est partout, répandu comme l’air qu’on respire. Elle est aussi mouvante, aussi fluide dans ses aspects innombrables que les courbes sans cesse reprises et corrigées des vagues de la mer.
Je la sens dans mes chromosomes, qui enflamme mes cellules et leur fatalité. Par elle je suis glissé au milieu des ruptures d’atomes, dans le balancement du destin des espèces et leurs luttes. Parce que circule à travers mon sang cette puissance de vie, je suis maître de moi, je me tiens en main, dans l’ordre où la création elle aussi est maîtresse de moi, en même temps qu’elle m’investit d’un pouvoir sur elle.
Parfois, elle s’amenuise jusqu’à l’épaisseur d’un rayon, jusqu’à la finesse de cil de l’eau, si bien que ma chair est gorgée de tant de souffle que je me sens flotter comme un duvet. Et elle me ride à peine. Nous nous reposons, alors, sur le plat d’un océan que nous générons de notre pacification amicale. Mais même dans cette inconsistance, il reste que nous sommes contenus dans la masse terrestre, et que seulement en transparence il nous est donné de pressentir que nous sommes là, à peine effleurés par la chérissable clarté qui cependant nous englobe.
Vers l’innombrable joie de ce qui est, la féerie me conduit et brise mon existence individuelle. En tête-à-tête perpétuel avec l’essence du monde, je suis l’une de ses gouttes où le désir de la vie explose et se déchaîne, devenu omniscient par la puissance de ma vue qui me plonge au sein de la vraie réalité. Insatiables alors deviennent mes yeux, parce que je suis dans une vacuité heureuse et que mes yeux ramenant le monde entier dans cette vacuité, un monde fugace, jamais semblable. Je rayonne cette vacuité, et le monde à son tour rayonne vers moi. Et j’arrive par la féerie à une sérénité qui est elle aussi vacuité. Ni amour de la vie, ni haine de la mort, ni affection pour moi, ni éloignement pour autrui. Ni le beau ni le laid ne me corrompent. Je ne sollicite rien en retour, et rien ne me sollicite.
***
Égale dignité de chaque chose ! Chaque chose participe à l’efficace infinie de la vie, grâce à la féerie. Et la féerie houle à la surface de mon corps qui en est frotté, elle traverse mes membres, éclate dans mes mains, crépite dans mes poumons en neige brûlante, en feu de glace, et je deviens le pivot autour duquel se créent et s’organisent les parties de l’univers, leur liaison, leur ligature. Je suis nombre parmi les nombres qui ordonnent la flèche de ce triangle d’oiseaux migrateurs qui coupent en grands vols le ciel d’équinoxe ; je suis cette assemblée d’arbres de haute futaie, fraîche comme l’œil, dans cette matinée suspendue entre de la brume et du Soleil.
Je pense féerie comme d’autres Dieu, et je suis possédé par la gravité des substances terrestres, comme les arbres, les fleuves et les bêtes. J’entre en féerie en écoutant le saut du torrent, le chant de la cigale, le criquet dans la lavande, le geai qui s’arrête devant ma fenêtre, le pivert cognant son bec sur l’écorce du pin, une branche qui bouge, ou mon propre sang qui coule.
La féerie est entre chaque objet, entre chaque homme, comme la lumière qui passe entre les phalanges de chacun de mes doigts. Pendant que je dors, elle l’ensemence et je suis affamé d’elle. Elle travaille en moi alors que je crois qu’elle est absente. Elle est emmêlée en moi, elle est entre les parois de mon corps, mon cœur marche dans ses avenues, car elle a tressé des dessins autour de mon cœur. Elle est mon enfance, elle me maintient dans l’enfance qui est l’authentique vivre de chaque jour. Le pain est féerie, la cruche est féerie, ma couche est féerie. Rien ne serait si la féerie ne le suscitait. Rien n’existe qu’en elle. La nébuleuse cosmique est par elle un globe de lumière où les apparences délivrent leur noyau, où les êtres se dénudent jusqu’à leur pulpe.
Je me vêts de la féerie, je fais entrer mes organes en elle, je bois sa lumière qui brûle le monde, et elle est ma brûlure qui rend chaque chose brûlante, le feu qui flambe la cage de mon corps, qui la fait craquer sans cesse si bien que mon feu s’unit au feu de la création et nous sommes ainsi, toujours un seul et même feu. J’afflue en elle par un flot ininterrompu et elle se déverse dans ma chair par un autre flot ininterrompu, et les deux flots se mêlent, comme du sang se mêle à du sang, ils sont de même nature et de même poussée.
J’ai de la féerie plein la gorge et les orteils. L’arbre de mon corps est aimanté de féerie et c’est de l’ingénuité jubilante qui la crée par une dictée mystérieuse que m’impose l’ensemble de la création.
***
Ma vie est celle d’un homme de désir. C’est aussi à se dépenser sans but que jouit ma force débordante, car le plus passionné des trouveurs de choses à aimer est encore aveugle parmi toutes les richesses à encore aimer du monde ! Et je suis pris aux pièges du monde, qui est ma fête continuelle et non point une pâle courtisane qui se met du rose sur les joues. Je ne regarde pas seulement la coque de la noix, je participe de la noix qui y est enfermée ; je ne vois pas seulement la lumière, je suis le pan de la robe du Soleil.
Je ne pourrai jamais aller plus loin que mes racines ni que mes liens terrestres. Jamais plus loin que la fleur du chardon, couleur de cheveux platines, ou qu’un marmottin rongeant une pomme de mélèze, ou que l’ombre, sous l’auvent de la cabane, pulpeuse et fraîche comme une tranche de pastèque. Si je m’apparente à l’escargot et aux rochers, je me solidarise aussi avec la flaque d’eau et le village en bas. Nos vertus sont semblables. Je me transfère si aisément aux pierres du sentier que je roule en leur milieu et suis emporté avec elles, lorsque je les balance, au loin, de la pointe de mes sandales…
Rien n’est vulgaire dans les choses. Elles sont des signes. Le sentiment de leur présence, déjà, est une bouleversante révélation de chaque instant. Je me sers d’elles et elles se servent aussi de moi, et quelle pureté que nous soyons ! II n’y a rien qui soit laid et rien qui soit beau. Il y a les choses de la vie qui sont également bien-aimées. N’est-elle pas allongée dans les ramifications de mes membres ? Ne se purifie-t-elle pas à ma salive ? Ne s’incarne-t-elle pas, en les sanctifiant dans les pièces de mes organes ? Mes os, mes ongles, mes membranes, les hémisphères de mon cerveau, les cloisons de mon cœur, la création s’aime en eux, elle leur a soufflé ses secrets, elle les a éduqués lorsqu’ils n’étaient encore qu’enroulés dans leurs embryons, échangeant entre eux, déjà en ce temps-là, leurs dialogues et leurs aveux. Il y a ma sueur et mes larmes, il y a les mucosités de mon nez et la cire de mes oreilles, il y a mon odeur d’homme et mon haleine, il y a les scories que rejette mon corps, à cause des coulées de ce métal franc qu’est mon sang en fusion avec la vie.
***
Entre mon sang et la rosée, mes bras et les branches, la couleur de mes yeux et celle de la nuit, la géographie de l’univers et les reliefs de mon corps, mes poumons et les méduses, les mandibules des insectes et mes mâchoires, il y a, qui passent et repassent en eux, les mêmes souffles vivants, il y a unité. Ils sont également dans le flux des images et des apparences qui déferlent sur la surface du monde, ils sont également arrosés par des émissions d’éclairs et d’orages, fécondés par le même jeu cosmique. Un galet est féerique, posé à plat sur la rive du torrent. Son existence est sœur de la mienne, en perpétuels ravissements, en activités émerveillées. Qu’une épaule de roche surgisse, et déjà elle est happée par le pouvoir des transfigurations ! Il n’y a pas d’objets laids et bas : la création est pleine de haute majesté, à tous ses étages et dans tous ses règnes !
Déconcertante lumière des objets, leur sapience et leur saveur jamais appréciées ! Et soudain, ils sont là, surgis comme des météores ou des personnages fantastiques. Entre le regard et la grenouille, entre l’œuf et l’oiseau, entre moi et la création, il y a filiation magique, identité claire de la lumière “levée”. Il y a la féerie de la pomme de terre, le vol des choucas, et il y a aussi la féerie des mélèzes, des ruisselets qui veinent les pentes des montagnes, des mains jointes, du rut des ânes, des torrents, des hommes, de la soie de la terre qui est douce au toucher.
Toujours cette double tonalité du “nous” où jamais ne peut se développer le monologue, le “seul”, “l’un”, mais le dialogue. Alors, comme mon oreille est active, comme elle se tend a ouïr, parce que déjà elle répond ! Recevoir, n’est-ce pas déjà donner, s’apprêter à la réplique de la donation ? Comment ouïr sans exprimer, et comment exprimer sans entendre ? La féerie n’est en moi que si elle peut aller hors de moi, que si elle s’offre à quelqu’un. La pensée la plus haute est sans substance si elle est sans allocution, et si elle est sans action. Je te vois et te comprends, donc nous sommes deux, nous sommes mille…
Indemne de contradictions, je le suis jusqu’aux extrêmes limites de mon être. Indemne des fléaux internes, ayant la fraîcheur d’un enfançon, ayant la joie spontanée accrochée à chaque goutte de mon sang, mon sang étant cette joie intarissable, uni à ce qui pénètre partout, adhérant à la continuité ininterrompue de l’univers.
Simplicité de mon être déduit de lui-même, tel qu’il fut à sa naissance, toujours en plénitude globale de tous mes sens. J’entends avec mes yeux, je vois avec mes doigts, je palpe avec mes oreilles. C’est par mon cœur, mon ventre, mes viscères que je suis aussi informé du monde, par mes cils, mon front, mon système pileux, en une fusion communielle. J’utilise mes regards de la manière dont j’utilise mes oreilles, et je fais usage de mon nez comme j’emploierais ma bouche. Mes sens ne sont pas partiels, mais ployés à la multiplicité des choses, rien ne les limite, ils passent à travers toutes les fissures du monde !
La réalité est action
J’existe sans me connaître. La seule connaissance que je possède de moi réside dans ce qui n’est pas moi. L’intuition ruisselante, le don de sympathie, l’adhésion qui me repoussent hors de moi, m’abouchent bien davantage à la gravitation des astres, à la succion des racines, et je me retrouve ondulant à la fois dans chaque être, et en-dehors de lui.
Alors vraiment, je me sens dans l’exaltation d’être, exaltation qui n’est pas faite d’images ivres, mais de réalités magiques, baigne dans le cosmos comme lui en moi est baignant. Ainsi étant, je demeure lucide, d’une conscience aiguë, les pieds solidement rivés à la croûte terrestre.
La réalité doit être une action et m’enserrer en tant qu’homme dans sa totalité. Elle n’est pas le fait du repliement sur soi, elle ne me détourne pas de ma personne réelle ni ne me dépouille de mon être, elle est d’un seul bloc ou n’est pas réalité.
Seule, de la sorte, la solitude donne valeur réelle à mes actes ; c’est elle la grande ordonnatrice. Sa loi est celle de la camaraderie. Elle me projette dans l’avenir, sans arrêt, cet avenir qui est la source du temps, puisque de lui se dévide le présent, qu’il le transforme en images, et que, par lui, je vois le passé s’éloigner, reculer.
Ainsi, l’écoulement des choses, le vieillissement des choses, je ne les décèle plus, parce que je suis en eux, dans leur succession, dans leur milieu. Tout me porte à explorer la conscience collective du monde extérieur et je hais de m’encoquiner avec mon enfer intime pour une figuration dont je serais le propre “voyeur”. Mon association avec l’univers a mis fin a mon individualité barbue : je ne suis plus moi depuis longtemps.
***
Si cette camaraderie avec la création est renoncement, elle l’est pour autant que mes antinomies se sont dissipées en s’accordant, et que je me meus dans la pluralité sans bornes à laquelle je suis identifié, recommençant ma vie à son point d’aube, en la sacrifiant, car elle n’a plus rien à demander a elle-même, mais tout à donner aux autres.
Pour avoir le regard fixe sur le monde et non sur moi, pour mesurer la ligne des crêtes de ces montagnes et non mes propres abîmes, il faut que je me rejette comme le serpent rejette sa mue, et que j’entre dans la vie universelle, créature à peau toujours neuve, frottée du sel et de la féerie du monde.
C’est pourquoi je ne suis jamais situé en un point particulier parce qu’il n’existe pas en moi de point fixe qui puisse être ma figuration interne. Je vais rapidement d’un jet à un rejet, tornade d’électrons, courant continu de radiations. Dans les jeux glissants de ma substance, je suis l’insaisissable esturgeon en migration, je ne suis réellement accessible qu’en dehors de mes fibres intimes, lorsque je m’écoule, lorsque je fais irruption dans les autres, et que nous devenons comme des tourbillons enlacés.
En cela, je ne suis pas un être particulier ; l’étant, je compterais pour peu, pour rien, car seule compte cette amoureuse tension de la sympathie et de la nécessité vitale qui attire les molécules des vivants, qui agglomère l’amour à l’amour. Ma vie s’adresse à la vie, comme les paroles brûlantes s’adressent à l’aimée, et je me propulse dans cette aspiration passionnée, afin que d’autres y répondent.
Dans l’immense flux des choses, impossible de n’avoir de but qu’en moi ni d’être gémissant dans mes limites. Pour qu’on me réponde, il faut que je me fasse entendre. Seuls, le duo, le couple, le mâle et la femelle, sont créateurs du merveilleux ! Seul le chœur à mille voix est le vrai chant des hommes !
***
Il faut que je sois jaillissant pour que je me porte à la rencontre du plus grand nombre et que la gloire de notre vie, ainsi affermie et accomplie, fracasse autour de nous la solitude négative, rejette ceux qui rongent leurs freins à l’écart, sans pouvoir s’en libérer net, d’un coup de dents. Qu’est-ce donc d’être ainsi isolé, sinon se placer en dehors des formidables crues de la vie et refuser pour une existence amère et dérisoire la grande bacchanale de l’univers ? Car il y a d’une part la virile joie d’être un créateur d’actes et un faiseur de vie, et de l’autre, celle d’être un petit tas risible et peureux qui se morfond d’être oublié sur le chemin du paradis…
J’ai choisi d’être dans les tumultes que se communiquent les torrents cosmiques, d’être ces tumultes et ces torrents, ou bien la roue que font les étoiles en se déployant, parce que je ne suis pas un homme du désespoir, et que je me suis toujours arrangé avec l’allégresse de la Terre.
Éclats et rebondissements liquides, fulgurations de feu, perméables, accessibles, mais il y a aussi le pain, il y a les mouches, les sentiers, il y a les corbeaux et les choucas et les taons.
Je suis ainsi pressuré loin de moi, retourné au dehors, et je sais que la création entière est aussi retournée à sa surface, avec ses vivants et ses morts, ses ordres et ses cataclysmes. Et que nous sommes tous enroulés dans les balancements de l’attraction joyeuse, un océan qui nous soulève — en vérité, nous sommes cet océan ! — si bien que nous ne demeurons pas plus séparés les uns des autres qu’une motte de terre d’une autre motte de terre, qu’une vague d’une autre vague.
Comme un arbre est pris dans le vent
En mon être, ce calme et cet équilibre, comme l’étendue de la mer sourde et onduleuse, d’un rivage à un autre rivage. Ces ports d’ombre, ces golfes de clarté dorment côte à côte dans ma vie pliée aux lois de la Terre. Le bleu que je cueille entre mes mains, c’est aussi mon corps entier qui le cueille, mais je suis cueilli aussi par ce bleu comme un arbre est pris dans le vent qui l’habille.
Je m’éveille à chaque instant, dormeur qui s’étire du dedans de son long somme, encagnardé dans ses membres, paupières baissées mais déjà picotées de jour, bien qu’encore tirées vers le noir de ce qui est l’autre versant de vivre. Il arrive que je sois alors remué dans ce sang qui cogne aux parois de mon corps, englué dans cette pesanteur, et aussi plus allégé de ma personne qu’une cruche de son eau.
Pour dire ce que je deviens en ces moments où mon être bat sa musique assourdie, à peine naissante, il faudrait que j’exprime ce que j’entends dire avec des mots différents à chaque pore du grand organisme que je suis. Car les poils de ma barbe ont leurs mots qui ne sont pas semblables a ceux de la plante de mes pieds, et mes bras prononcent des paroles qui n’ont pas la même signification que celles de ma bouche. Et mes ongles, mes poils, mes yeux et mes oreilles parlent aussi, chacun, leur langage extraordinaire.
Toutes ces images se fracassent le long de mes membres. Mon haleine en est odorante, parce que du fond de mon palais qui les happe, elles éclatent jusqu’au chaud de mes lèvres ; mes doigts sont heureux d’avoir joué avec elles, c’est pourquoi leur dactylité est devenue intelligente. Mon sang en est plein à ras bords, et il a le soyeux de la feuille moirée du rhododendron.
Les images lancent des formes et des couleurs jusqu’au plus secret de mes cellules, et des odeurs aussi qui ne sont pas seulement d’herbes et de fleurs, mais sont l’essence même de l’univers qui saute au centre de mes rétines, jusqu’à l’extrême cavité de mon cerveau, parce qu’il est en amour de moi. Ses puissances passent à travers ma vie comme les miennes se nouent en lui. C’est moi qui fais rouler ses trépidations par son immense rondeur du même mouvement que mon sang qui gire et où sont inscrites ses volontés. Si les bourgeons se bousculent sur les nœuds des branches à qui sera le premier la pointe verte criant la venue d’avril, c’est que je suis en chacun d’eux et les pousse à pétarader des étoiles de verdure !
***
Cet univers, fluide et léger dans ma poitrine, les mots parfois y crépitent et grandissent à la façon des flammes, des mots qui n’ont aucun poids, qui ne correspondent pas à des objets visibles, et où n’est concentrée aucune pensée. Là, dans le monde des vocables qui poussent et qui grondent, je ne choisis pas, je suis choisi par le frémissement indomptable qui me transporte. En moi s’étirent des figures, s’éveillent des rites, se forment des danses qui dans un tourbillon s’échappent de mon corps, comme d’une cage. Rien n’est coordonné, et tout cependant se stabilise et s’enchaîne. Et lorsque les mots passent ma bouche, ils sont brûlants de mon sang.
Ils naissent en moi, comme si pour la première fois, je les avais entendus. Je les regarde naître avec de gros yeux ronds de surprise. Je suis alors identifié et par eux je prends racine et mon langage devient celui du blé, de l’eau et des mélèzes.
Je suis dans la féerie au-delà de la parole, et pourtant au moment de la surabondance qui me comble, comme les flots crèvent les digues, les mots montent à l’assaut de mon esprit et me submergent. Je ne suis pas libre de choisir : quelqu’un me dicte derrière mon dos, et je reprends sa dictée, sa dictée qui ne s’appuie sur rien. Elle ne s’alimente d’aucune contrainte, je ne suis pas le récitant, mais le récit. Je suis une oreille qui écoute. Mon cœur ne réclame aucun effort : il est brûlure.
Je ne sais pas comment cela naît. Cela est d’une seule coulée. Je ne sais pas ce qui se prépare en moi : c’est une voix qui me vient et que j’écoute, sans rien lui demander.
Parfois je l’appréhende, je la saisis, palpitante, comme on saisit une fibre vive, avec la puissance des mots. Je la soutire du silence formidable qu’elle secrète autour d’elle, et les paroles que me délèguent les êtres et les choses ont la palpitation même de l’univers. Alors, je m’aperçois que je connais des maîtres-mots, ceux qui apprivoisent les serpents et les esprits, je les prononce comme un enchantement, et ils sont dociles comme les pigeons qui viendraient picorer dans le creux de la main.
***
Je m’aperçois qu’il m’arrive de reconnaître en mes mains et en mes regards une grande puissance qui espère et qui gît au cœur de chacun, car chacun est en moi de je suis en chacun, par la lumineuse vertu des choses dites et écrites.
Et les récits qui sortent de moi sont vrais, m’en croyez. Les choses visibles sont le surnaturel. Étonnez-vous d’un œuf lisse, car il est un oiseau fabuleux ! Étonnez-vous d’une goutte gommeuse, car d’elle a surgi cet homme que vous êtes ! Je suis à l’écoute de la féerie et c’est en même temps vous tous que j’écoute. Je fonce dans la masse virulente de la vie, et je suis ce qui remue, ce qui carapate, ce qui flue, et je vois ce qui est le jour et ce qui est la nuit, et les instants entre le jour et la nuit. Lorsque la féerie me gagne, je perçois le son de l’air, le tourbillonnement du soleil. Je joue avec les végétaux des solitudes. Je suis sable dur et glaise poreuse, je suis le grain glacé de la peau du lézard.
Je le dis en vérité, et j’en suis sûr, comme je suis sûr que je vous touche : quand ma langue bat au creux de mon palais, comme une flamme frétille dans le verre d’une lampe, elle éclaire mon corps d’une clarté réelle. Lorsque je parle de la féerie, c’est comme l’entrée en moi d’une cavale magique dont les prunelles brillent bellement. Ma propre voix me gagne comme un grand amour ou comme un cyclone qui ravage. Il circule dans mon sang une liqueur capiteuse qui me transporte aux extrémités de l’univers et de moi-même. Ces figures qui se suivent et se bousculent en-dedans de ma chair, comme le mâle dans la femelle, ce sont les montées et les descentes du feu de la soif, et aussi les coulées de l’eau fraîche dans la gorge qui boit aux fontaines de vie.
J’entends ma voix s’élever en amplitude, et voici un chant qui ressemble à ceux qui montent de la cour des mosquées lorsque les oiseaux du ciel se posent sur les colonnes blanches !
Ah ! la féerie est partout, aucune place n’est vide. C’est le bruit de la foule de mon sang qui éclate dans les mots que je dis, et comment fuir alors devant la galopade de ces présences innombrables ? Mais les mots s’échappent de mon être comme le poisson du filet du pêcheur, et de même que dans l’eau un visage répond au visage qui s’y penche, ainsi ce que je dis de la féerie répond aux paroles qu’elle éveille en moi.
Article suivant — Plus loin que l’homme