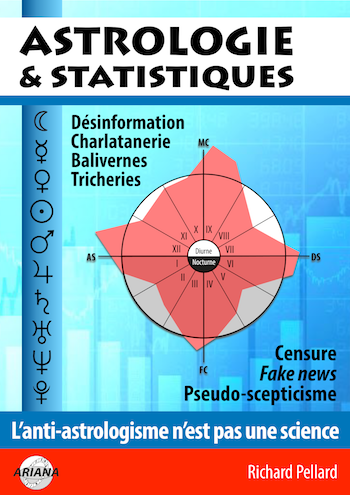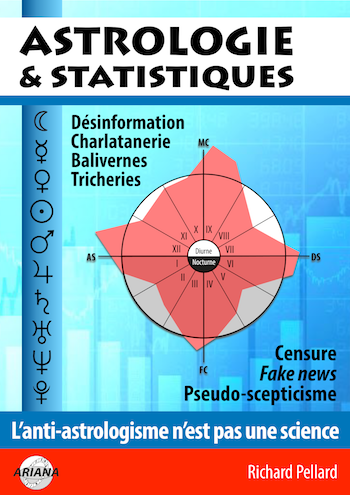La féerie n’est pas une sorte de laborieuse élévation qui, au fur et à mesure qu’elle se crée, délivre le mystique du langage, et la dessèche, comme si la parole ainsi raréfiée, avait pour destination de se résoudre en silence. Mais la fonction féerique est de susciter et de projeter le mythe de l’homme, de jeter des racines de créature à créature. Elle ne peut être exprimée par un seul, elle ne peut et revécue par un seul, mais par tous. Le langage doit être communicable, la poésie doit être à tous, dans sa pureté et sa densité. La tragédie d’un seul n’est qu’une cruauté de plus ajoutée aux cruautés des hommes qui sont seuls.
Entre l’univers et moi, peut-il ne pas y avoir jonction ? C’est pourquoi, si je dis, si je donne, je ne profère, je n’offre que ce que j’ai reçu de ce qui nous est commun, de ce qui est de la grenaille éternelle, de ce qui est du vieil homme de l’univers. Mes mots ne sont communicables que parce qu’il y a va-et-vient entre moi et un autre, dialogue balancé. Que si je me rabattais sur le ronronnement intérieur, je repousserais une voix dans la géhenne de l’énervant silence et la lumière d’or de mes yeux se résoudrait en ombres, alors que l’expression est ce pouvoir féerique qui me maintient en avant de moi, en dehors de moi.
Pas plus que moi, mon langage n’est immobilisé. Mais il est toujours en instance de se créer dans le clair espace du monde. Je lance mon énergie créatrice — comme le pissenlit ses Soleils de duvets et de semences — en mots, je veux dire en actes, libération du vaste monde de ma chair dont elle a bénéficié par l’équilibre puisé dans la bouleversante réalité de la féerie, dans l’amour que nous faisons l’un et l’autre, parmi des symboles et des mythes qui traversent nos corps en météores.
Ce qui s’arrache ainsi de moi, c’est le langage de la féerie. Plus celle-ci est en plénitude dans mon être, plus nous nous aimons, plus vaste est l’englobement que ma prise capte de l’univers. Elle est aussi inépuisable que mon destin d’homme que je poursuis, qui mobilise les autres destins venus à ma rencontre, qui fait de cette rencontre l’essentiel de son destin. Elle m’ouvre, par les mots, l’accès de tout le possible et de tout l’impossible de la création, qui se fait en même temps que se font les mots naissants d’elle. Ah ! que le langage peut être rond comme la Terre, lorsqu’il brise le mutisme qui scelle les cœurs des hommes, lorsqu’il rompt la surdité de leurs oreilles et que soudain les hommes se penchent avec une attention passionnée sur l’abîme de joie ouvert devant leurs regards ! Parce que, emerveillés, ils voient se dérouler la vaste création habillée d’images et de secrets ! Parce que l’usage de la parole leur a été rendu, éveillé par le pouvoir de ma parole, ce pouvoir qui devient aussi le leur !
***
Communication virile qui appelle les êtres et les choses éblouis à se reconnaître dans le rythme et l’action de ce que je dis, accordés aux rythmes et à l’action de ce qu’est la création. Car mes témoignages, ces messages que je délivre, je ne les traduis pas pour moi seul, nourris de vertus individuelles. lis vont aux autres, ils naissent pour les autres. Naissant pour ma propre délivrance, ils seraient de peu de souffle, de peu d’ampleur ! Penché sur mon papier, ce n’est pas moi que je vois, ce n’est pas à moi que je m’adresse, mais aux milliers d’autres que je vois, aux milliers d’autres dont mes écrits sont responsables. Disant la féerie, je parle pour mes semblables, je parle d’eux dont elle est le pain quotidien, sans qu’ils s’en doutent.
Si je parvenais à la restituer pour moi seul, ce serait esquiver la justesse de mon dire. Il me faut des compagnons qui écoutent, il me faut l’auditoire du monde, d’un horizon à l’autre, pour savoir si ce que je dis est vrai. Et que les bêtes et les végétaux soient eux aussi à l’écoute, soient mes écoutants, et me jugent. Sans eux, pourrais-je articuler les vocables, sans eux l’expression prendrait-elle sa plénitude lisse, sa vérité du moment ?
***
Je ramène mon ivresse au-delà de mes lèvres, pour que d’autres sachent et sentent passer en eux cette présence double, acquise par moi et par les choses réconciliées en une bienheureuse mêlée. Seulement, ce passage du vécu à l’écrit est déjà une suite de morts, de lâcher de la crépitante lumière attachée à l’instant éternel où se fit cette conjonction entre le monde et moi.
***
Dire que je suis en solitude, c’est déjà ne plus l’être, puisque le dire, c’est encore quelqu’un qui m’écouterait, et que communiquer par la parole, la solitude ne m’isolerait plus. Écrire que je suis seul et qu’entre moi et cette affirmation s’insère celui qui la lit, c’est prendre conscience de cette solitude à deux : ainsi ce serait tricherie. Le silence dans la solitude, les lèvres closes, ce serait vraiment comme si j’étais gisant et immobile au fond des ténèbres, sans qu’aillent et viennent plus jamais mes poumons dans l’air auguste de la création. Ce serait trahir ma dignité d’être, ma condition d’homme pour qui le langage demeure l’essentiel fondement, puisque vivre en autrui, c’est communiquer avec lui par la parole, suprême protestation contre la mort et la stérile solitude !
Je jette un cri : ma voix s’élève, et ma signification d’homme est réhabilitée, est rétablie !
Certes, en même temps qu’il détruit cette solitude, le langage témoigne de sa réalité profonde, et je demeure seul, puisqu’il faut prendre mon essor hors de moi-même, hors de mon isolement grâce à la complicité verbale que fixe ma plume. Néanmoins, ces montagnes où le langage est une réalité muette, demeurent pour moi le domaine de la communication entre toutes les fraternités : là, j’ai vaincu cette solitude par la féerie, dont je tire ma nécessité d’être dans le monde, côte à côte avec les hommes, en l’acceptant, en m’acceptant en elle, sans pouvoir l’exprimer.
Captif sous l’écorce des choses
Cet apaisement qui me submerge d’être en face d’une fourmi, et ce repos sans fin qui se glisse à travers les ramilles de mes muscles à regarder longuement les stries d’un caillou, les jeux des pattes d’une mouche, le rond d’un remous d’eau ! Ce calme sans rides, cette immobilité de moi-même dans la paix de cette transmigration, car je suis là, loge dans ces choses, allant et venant dans ces vies ! C’est une méditation de mon corps en parenté avec la création. La marmotte, l’écureuil, le shipmunk méditent ainsi, qui sont sans cesse unis aux profondeurs de la montagne et de l’éther, lorsque debout sur leurs pattes de derrière, ils contemplent sur le socle d’un rocher les choses autour d’eux.
Je suis membre de ces longs chapelets de fourmis, je fais partie de leur caravane besogneuse. Je fais sauter les charnières et les coutures de ma peau, je suis une fourmi, je me déleste de ma personne d’homme et je suis un insecte, ou une gousse d’ail, ou une crotte de chèvre, ou de nouveau un autre homme, tous les autres hommes.
Féerie de l’instant en qui débouche la cime de ma vie, elle me porte, berce, comme de vague en vague, sur les diverses formes de la joie. Jamais d’itinéraires retracés en arrière, ni qui s’en vont se perdre au loin en itinéraires de fuite. Ah ! Qu’ai-je à faire de plus de richesses que cet instant n’en appréhende ! Ces moments, cloués là, par le poids des secondes et qui débordent en abondance et en fraîcheur sur l’existence entière, ceux-là seuls sont la vie et mon être en est charge et souriant.
Je suis captif sous l’écorce des choses et dans la marge de silence qui enrobe les choses. Chaque fois que me frappe la féerie, je rends une pleine sonorité, une couleur et une forme pleines, et c’est à chaque souffle qui entre et sort par mes narines le passage de la féerie en moi qui percute mon corps. Elle me convoque et je la convoque, et je suis par elle intégré et désintégré tour à tour dans le chaos adorable.
***
Il y a ce lézard que je connais et qui s’ensoleille, assommé de calories, le cœur battant à la même cadence que les ondes de chaleur qui emmaillotent l’univers montagnard. À coups de glissements saccadés, il s’est coulé de dessous une pierre, puis s’est arrêté là, à ma portée, les pattes écartées, au repos. Le grain de sa peau porte des signes de ténèbres, il est comme le tissu du monde, soyeux et à papilles en même temps, triture dans des couleurs de nébuleuses. Malgré sa fixité de bijou, il est pourtant tourbillonnant, pris dans les rotations et les balancements des choses et c’est en eux qu’il puise sa paisible indifférence de pierre ou d’astre. Soudain, cette flamme verte et couchée s’est déchaînée d’une détente formidable, dans un calme sans bornes, dans une maîtrise de soi qui aurait été rouerie si elle n’avait été la forme même de la fatalité des lois de la vie qui dompte toutes les fièvres. Car le lézard a foncé, avec sa languette en stylet, sur une mouche, et l’ayant harponnée s’est mis à la mâchonner posément, en l’agglutinant, ses prunelles de bête préhistorique tantôt ouvertes, tantôt fermées. Un chapelet de minuscules glaires noires comme du caviar, a soudain poussé à l’extrémité de sa queue. Maintenant, il m’observe, un peu sur les flancs. Nous savons que nous nous sommes rencontrés, que nous sommes là, de même nature, de même famille. Car brusquement, il se livre à moi et je suis devenu lui, et brusquement je me livre à lui et il est devenu moi. Alors, nous plongeons, notre identité reconnue, dans notre domaine originel, et je saurai raconter la longue histoire de notre plongée et comment nous en émergeâmes…
***
Circulation en moi des principes vitaux, circulation en circuit ouvert et ferme tour à tour, comme l’embryon, comme le nouveau-né, qui doit à cette science, qu’il n’a pas encore oubliée, la souplesse de ses membres. Qui, un enfant, à la fois plante, fragment de roche, marmotte, et source vive. Raffinement de ma puissance virile, et cette noblesse de la chair en laquelle me respecte la création. La possédant, je sais que je mets en jeu les forces cosmiques. Je reçois de celles-ci autant que je leur emprunte, et leur infuse un merveilleux ébranlement. Ce pouvoir dont je dispose, il est en chaque être, scelle, dépositaire d’un singulier sortilège, aux sens encore aveugles, mais d’une naturelle possession pour ceux qui savent que la féerie est le sang de la vie de chaque jour.
Je parle, et c’est féerie. Je respire, et c’est féerie. Je marche, et c’est féerie. Tout est féerie et laisse sur moi, autour de moi, des traces, comme la bave d’argent de l’escargot partout où il souligne ses routes légères.
Je me surprends, parfois, investi d’une force d’influencement sur l’univers, et je m’en sens épouvanté. Mais ce pouvoir d’imposer aux choses ma volonté, coïncide avec la volonté des choses. Cela me traverse comme une décharge à l’aide de ma chair épanouie, à l’aide des symboles que les apparences expriment, qu’elles contiennent, et qui portent en elles des efficacités particulières. Je comprends ce qu’affirmait la sagesse de Lie-tsen, lorsqu’il enseignait qu’il suffisait à un guitariste, s’il désirait en plein hiver rappeler l’été, de faire sonner sur ses cordes celle des notes de la gamme qui a des rapports emblématiques avec l’été, avec le rouge, avec le midi. Car la note exprimée capte dans ses vibrations l’énergie mâle du soleil, de la puissance chaleureuse des mois du Midi flamboyant…
Ainsi, je germe et je monte comme le grain de blé, et c’est la féerie qui est ma germination. Je suis l’alouette : le ciel est trop étroit pour l’ampleur de mon vol. Je me suis débarrassé de moi comme le feu de la forge chasse les impuretés du fer. J’ai rivé la féerie à chaque particule de ma chair, comme on rive des clous dans du bois. Elle me taraude, elle est visible à travers moi comme un brasier, elle fait irruption en moi comme une eau, elle est insérée en moi comme dans un tissu ! Entre la féerie et l’homme, il n’y a que l’épaisseur de l’azur : je troue cet azur, je l’éventre, et je roule dans le ciel terrestre ! II n’est pas de créature que la féerie n’entraîne par les cheveux, par la plante des pieds, par les pores de son derme. La voie féerique, la priapée féerique, sont le sel de la Terre. Je suis dans la féerie comme le dattier dans son noyau. Le monde s’inscrit dans le lustre de ma prunelle, et j’imprime ma forme dans la féerie du monde. La créature baigne dans la féerie, et la féerie s’y crée, secrète et merveilleuse !…
Une ombre dans l’obscurité vivante
J’explore la nuit qui investit ce lieu. La pâte d’ombre où tout se défait, peu à peu, me recouvre. Sur mon visage, dans mes mains je sens glisser l’air frais qui arrive des crêtes par petits bonds, et ma bouche savoure ce vent libre et la substance de cette nuit. Il y a de part en part de cette étendue une tombée de suie impalpable qui charbonne. Dans le plein du jour, je me vois, je m’imagine, mais ici, mes limites sont abolies, les gestes que je pourrais esquisser sont mangés par les ténèbres. Et il semble que le noir de cette nuit se soit précipité, par mes narines, ma bouche, mes oreilles au fond de mes organes. À peine les découpures des aiguilles détachent leur épaisseur sur cet écran noir sur noir — un peu plus de nuit sur de la nuit — d’une ligne imperceptible qui perd son tranchant. Vais-je devenir dans cette obscurité vivante une ombre qui s’ignore, une petite ombre parmi les ombres, attachée à l’ampleur sans bornes de l’esprit de la nuit qui berce le monde ?
II y avait eu, tout d’abord, ce pâlissement des choses avant l’obscurité, cette clarté unie et transparente qui touchait à peine à la nuit, mais qui n’en était pas encore, qui allait se fondre dans l’ombre mais qui s’y jouait à peine et me donnait le sentiment que c’était ma vue qui se voilait et non pas cette clarté qui baissait lentement et s’en allait. À travers ces vagues lueurs, la survie du jour rejoignait la pointe première de l’aube. L’herbe recevait la mouillure de la rosée, doucement prise de scintillement. Et il y avait encore la chaleur du jour qui couvait dans les rochers et les plantes comme celle d’une joue en feu.
La fantasmagorie des grisailles imperceptibles et ces gouttes du ciel qui se transfiguraient avant la venue des étoiles, avant la minute émerveillée du jour qui s’abîmait, se déployaient devant moi. Puis, le plateau, les replats, les vires, cette cabane qui dominait l’immense combe solitaire, s’effritaient dans cette épaisseur et en même temps dans ce vide de l’obscurité qu’on ne trouve nulle part ailleurs qu’en montagne.
Et jamais, plus qu’en ces instants, je ne me sens aussi pur, aussi spontané et neuf. Et des nuits comme celle-ci, il faut qu’il y en ait dans l’existence d’un homme…
***
Car c’est toujours de nuit que les choses se libèrent, qu’elles déchargent des silences, des effluves, des frissonnements. Silences gonflés dans les cailloux, silences qui roulent sur les pentes, secrètes émanations des torrents, des bêtes en chasse, de la flore en travail, frissonnements des rocs qui se délitent, et toutes les dents des choses qui rongent, toutes ces choses qui s’effritent ou croissent et se multiplient…
C’est la montagne qui donne naissance à l’ombre, et dans ce morceau de nuit qui la recouvre, la montagne retrouve sa part de sauvagerie plus que dans la lumière du jour. Dans une odeur d’eau et d’herbe, elle se refaçonne pour ainsi dire, revient à ses initiales lignes de montagne libre et purifiée. Alors, elle s’enfièvre d’un air de monde neuf, d’un air de monde préservé. Ces hauteurs enfoncées dans les astres et rien que les essentielles puissances qui les pétrissent, c’est la vraie fête de ces rocs rendus aux ténèbres natales.
***
Cette prise de contact avec l’univers, faite d’échanges et de rencontres, cette qualité de la présence humaine qui éveille et suscite dans la solitude d’autres présences, ne me quittent jamais. Dans les silences et les frémissements de ces plateaux que la nuit mère, toujours mon esprit s’aiguise et s’affine avec d’infinies palpes et demeure perméable à la perception élémentaire de la vie éparse. Son acuité n’est que l’intelligence d’un instinct toujours en liaison prolongée avec les choses de la Terre et de l’espace. Ma chair entière est braquée, en arrêt, sur la croûte du ciel, sur l’écorce de l’univers, vigilante à ausculter, à flairer et elle est, à son tour, scrutée, tâtée par la matière féerique.
Rien n’est épais en moi, ni hors de moi. les prémonitions, les bouleversements, les signes avant-coureurs des forces premières retentissent dans mon être et me régissent. Les signaux de l’inconnaissable jouent dans mon sang comme sur un miroir. Toujours cette recherche précise en moi de la rencontre et du contact. Et je sais que mon existence, ici, comme les autres, ailleurs, donne du prix à ces montagnes, à ces prairies, par mon intégrité charnelle.
Je lis avec les yeux de mes sens les approches de l’orage, les menaces et les bienveillances de la nature, les traces dans le roc et dans l’herbe, tout ce qui alerte mes instincts, dresse ma conscience aux écoutes de ce que l’univers confie aux quatre points cardinaux de la vie et qui frappe la plaque la plus sensible de mon être. L’acuité de ma vue dans les ténèbres, comme celle de mon ouïe qui saisit les sensations les plus fugaces, rejoint l’intelligence de mon corps qui sait aussi enregistrer des images acoustiques, des ondes visuelles, les plus légers repères de ce qui se trouve encore logé dans les alvéoles de l’inconnu.
Toujours, je suis orienté dans les directions dominantes de l’univers. Dans la nuit des plateaux, l’animation des choses fixe mon pôle — la boussole de ma féerie — et me montre les routes des hommes. Ces orientations sont enroulées dans l’écheveau de mes veines, comme si ma mémoire possédait une science du repérage et une toponymie singulière qu’un simple frémissement suffit à éveiller dans mes sens où se croisent les multiples itinéraires du monde. Mes pouvoirs d’homme ainsi décuplés, la solitude de cette nuit est pour moi pleine du tumulte de la vie endormie, tandis que la paix conserve à mes yeux leur lucidité sereine.
Tout ce que je sais de moi
Je suis celui qui hante les solitudes, loin des sentiers des hommes. Mais que suis-je ? Je ne me connais pas. Il m’est impossible de dire : ceci est moi. J’ai cinquante trois ans et ne saurai jamais qui est Albert Sarallier. Si je cherche à établir de moi une image où s’inscriraient les contradictions, les déchirements, les impulsions de mon esprit, dès qu’il est mû par les rouages de la convoitise de soi, si j’ignore mes reflets, insaisissables et fallacieux, et dont je n’ai que faire, saurai-je davantage vers quelle fin j’avance ? Qu’ai-je à attendre de je ne sais quelle révélation et quelle grâce qui brusquement m’illumineraient ?
Solitaire au milieu des multitudes vivantes, je ne redoute pas l’âpreté des soirées sans témoins, la cabane sans voix, les étendues montagnardes, ni le face-à-face avec moi-même. La solitude est plus rigoureuse, plus tyrannique pour ceux qui ont su découvrir les secrets de la Terre et qui, d’un Soleil à l’autre, ne se dérobent pas au poids des jours qui se ressemblent.
Je vis dans un apaisement de l’être qui pourtant, n’est pas joie quiète. La création recouvre mon anonymat. Je ne me dresse pas contre elle ni contre moi. Mais je ferme les yeux sur notre pureté terrible, celle des naissances et celle des morts, que nous connaissons bien.
***
Ces successifs paliers qui m’ont conduit au seuil de la solitude, et dans ses profondeurs non déchirées, de pleine lumière, furent un itinéraire allègre que je pris pour y parvenir, avec cette grandeur des plateaux du Vercors, cette paix âpre, minérale — une tranquillité de fin du monde. Miroir de l’espace, non seulement au-dessus de moi, mais baignant aussi les masses des cassures des monts comme du mercure éparpillé, et mon être pris à chaque pli de l’air, dans chaque maille de l’azur ! Jamais seul, et jamais en retraite dans l’espace du dedans ! Transparence de la résine, je la suis, et ce sol bouleversé de la préhistoire dans lequel je me tiens englué comme un coquillage millénaire, mais qui chante encore parce qu’il est vivant, je le suis aussi. Solitude, ma mère, qui veut que je sois dans la vie et dans la mort, dans le clair et dans le noir, dans toutes les faces opposées des êtres et des choses, solitude qui même dans l’amertume me gorge d’un contentement venu hors de moi, solitude pesée à la balance du temps qui ne ment pas ! Entre la joie et cette absence de toute connaissance de moi-même, il y a liaison étroite, il y a vérité de lumière.
C’est tout ce que je sais de moi.
***
Point de fin, ni de mot de la fin à trouver dans la solitude. En vain y chercherais-je une tentative de forme à mon existence. Je suis plus curieux d’autrui que de moi, moins complaisant à mes réflexes les plus fugitifs qu’à ceux qui animent mes semblables. J’ai une sorte d’inaptitude à me comprendre, je demande tout aux autres, et rien à mes rêveries. Car j’ai oublié depuis longtemps de me quérir, me retrouvant sans cesse dispersé dans l’univers qui toujours me précipite hors de mon fond, étant plus capable de m’instruire que tous les printemps et orages intérieurs.
Je n’ai pas pris de l’altitude pour mieux scruter les hommes en me considérant comme un héros. Je ne poursuis pas, des sommets de ma solitude, ce qui noue les êtres les uns aux autres en m’excluant de leur communauté, mais pour les mieux voir de loin, pour mieux assurer leur liaison et dépister ce qui les mettrait en péril, en m’écartant d’eux. La solitude n’est pas une méditation passionnée, une volonté d’âme seule qui s’élève et se fait invisible comme les divinités et les choucas.
Pour tirer de moi mes plus grandes ressources, il me faudrait une ivresse qui me maintienne en vigilance, et cela s’appellerait fausseté ou bravade. Je ne me suis pas fait de mon esprit un haut lieu, ni une montagne où me retirer. Je ne vis pas dans la conscience divinisée de moi-même, par une provocation continuelle de mon individualité, ou une politique savante de mon imagination, ou à coups de superbe, en me fouettant l’âme. Je ne m’efforce pas de différencier des autres dans le sentiment de ma singularité.
Ma part essentielle se trouve chez autrui, elle m’est déléguée par autrui. Entre mon être et le monde, le “je” serait un abîme. En moi, je ne découvrirai pas de salut. Atteindre cette affirmation monstrueuse qu’il n’y a que l’idée que je me fais de moi qui soit valable, ce ne serait qu’une déroute, et multiplier mes propres images dans un miroir.
De ce fait, rien en moi ne m’inflige l’erreur de mon insuffisance. J’ai ma place dans le contentement de mes mains et de mon cerveau, à l’intérieur de mon métier que je parachève, par d’humbles réussites, d’humbles perfectionnements.
Ma misère et mon infirmité morales ne sont que des fantasmes. Je suis un peu de chair autour d’un bâtis d’os, de la matière animée, traversée de rotations, de remous, vrillée vers le dehors, en plein Soleil, agneau nouveau-né qui a sauté hors de sa mère, plein d’étonnements et de gaucheries, féerie que je suis, de part en part, à l’égal de la flore, de la faune, des minéraux, et leur allié…
Je suis illuminé par les quotidiennes charges d’images, aussi légères que le remuement d’un lézard. Je me quitte à chaque pulsation de mon sang, et ainsi me dépasse, d’un dépassement a fleur de vie, au ras du sol. Et je communique par le don de moi avec ce qui m’entoure, et suis perméable à l’offre que chaque chose me fait d’être mon fraternel camarade sur le chemin de la vie.
Ma liberté n’a d’autre raison d’être que la liberté d’autrui. Il n’y a pas de liberté pour l’homme seul. Elle serait alors, dans sa réalité, celle de la lâcheté.
Mon activité dans cette solitude porte avec elle un sens du repos. J’œuvre dans l’univers, et en même temps, je sens que je ne fais rien. En pleine puissance d’acte, je suis parfaitement au repos. Et ce repos qui est mien, d’une nature particulière, est débordant d’une intense volonté, un tourbillonnement d’énergies rapides et sûres, et cependant tranquille, immobile, comme l’axe d’une sphère dans ses rotations.
Mon moi personnel, où peut-il se situer dans cette opacité merveilleuse de l’être ? Depuis toujours, je suis un non-moi, absorbé dans un non-moi qui est le tout de la création. Intégré au cœur de la féerie et de cette pacification enivrante d’une vie placée au-delà de l’être et du non-être, d’une vie formidable, réelle, avec tous les sens, tous les instincts palpitants et lucides, il semble que le sujet et l’objet que je suis, sont abolis dans une union où je me vois simultanément toi et moi, tien et mien, c’est-à-dire cette entité “nous”, qui est une ligature du sang universel !
L’essentiel est d’être les autres
Je suis dans la solitude du nomade, citoyen du monde, projeté loin de moi dans chaque vie à naître, libre de moi, tourbillonnant dans les flammes invisibles de la création, semblable et différent de toutes choses, écume, Soleil, pierre sèche, herbasse, fourmi, bestiole à poils ou à écailles.
Mes membres ne sont pas isolés, ni mon sang, ni mes cheveux, ni mes lèvres. Ma chair organisée est en compagnie avec la chair de l’univers. Si mes paupières clignent, si mes doigts se referment, il y a chaque fois capture de mille vies, par des coups de filets fabuleux.
Je suis ce que je suis, le monde est ce qu’il est ; nous ne nous dressons pas l’un à l’autre des pièges à pensées. Silencieusement, nous sommes l’un dans l’autre mêlés, sans frontières, et la paix est là, et le repos est là, simplement. Aucune opacité : je suis transparent à l’univers, et l’univers m’est ouvert, de part en part. Je ne dispute rien en moi, je ne déduis rien de moi, puisque je suis ce feuillage viré vers la lumière et qui respire, puisque je me tiens au niveau des insectes, des quadrupèdes, des racines, des fluidités.
Autour de moi, ne surgissent pas les spectres tremblants, les “doubles” que j’ai rejetés, les espérances de mes années passées, les amertumes de mes capitulations secrètes. Je n’ai pas choisi dans la réalité, par un choix total, celui du désespoir, celui d’une vie sans élans. Je suis au milieu des choses, dans leur renaissance incessante, plein de leurs chants d’énergie et de leur active joie. Ma conscience ne se regarde pas vivre, même esthétiquement. Je ne me délivrerais pas, en délivrant mes fantômes.
Je ne me dépouille d’aucun fardeau de mon humanité, sinon celui des lobes qui palpitent trop vite dans mon cerveau, et qui me sont superposés, et vains. Ma sérénité est une naturelle bienveillance, un sourire acceptant, comme celui des animaux ou des plantes. Et cette sérénité me rattache aux différents degrés de la vie, parce qu’elle est le don que la vie m’a fait.
***
Je ne suis détaché de rien. La joie pure de l’eau ou de l’insecte, la joie d’être, me possède dans chaque recoin de mes organes. Ma solitude n’est pas une réalisation ou une expérience propre : le mélèze qui fuse, ancré à la proue de ce piton, dans son isolement, ne poursuit d’autre aventure que celle de ses aiguilles, de sa résine, de ses cônes a écailles. Rien en moi de cet esprit tourmenteur qui se veut creuser une vie personnelle, une solitude où l’on devient soi, avec rage et angoisse. L’essentiel est d’être les autres. Etre moi dans ma joie, connaître seul ma joie, n’est rien. Ma personne dépend de ce qui est hors de moi, elle est la mesure de la réalité extérieure qui la façonne. Je ne suis libre qu’autant que le monde dit “oui” à notre rencontre, qu’autant que je l’accueille et que les autres hommes sont libres.
Je ne suis pas seul. Mon identité ne m’est perceptible que parce qu’elle est rattachée à ce qui m’entoure. Je ne puis me considérer isolé, comme un météore suspendu dans le vide. Je suis seul dans la mesure où je médite et observe, dans le paisible recueillement des choses. Certes, dans l’isolement, un seul personnage comme moi dans un si grand cadre, et un si grand cadre pour un si petit personnage, c’est le vide illimité, mais je les remplis l’un et l’autre par mon identification avec la vie.
***
Je me replace non pas au centre, non pas au-dessus ni au-dessous des lois de l’univers, mais dans le milieu de leur courant, au rang des autres créatures. Vivre, c’est sortir de soi. L’observation dont fait preuve l’homme en solitude, par ses sens tournés vers la connaissance des objets, cette vue, non pas dardée au dedans mais au dehors, est le contraire de la solitude abstraite. Je ne tire nulle présomption de mon orgueilleuse raison solitaire. J’accepte en bonne part les choses, au visage et au goût qu’elles se présentent à moi, le demeurant est hors de ma connaissance.
Je ne me connais que par mon corps. Mon corps est la seule merveilleuse réalité qui me soit perceptible. C’est lui qui est le lien entre ma pensée et l’univers. Vie remuante que celle qui anime ce corps et ses volumes, figure ivre des attributs de la réalité vivante. Rien en lui ne se déroule dans la pénombre. Mon sang est cependant habité de rêves avec lesquels il joue, dans son épaisseur de flammes, dans ses sillages d’oiseau.
Entier, intact, je le suis, dans ma virilité et ma force d’homme, sans aucune poussée vers le haut ou vers le bas de ce que l’on appelle le bien et le mal. Tout entier me tenant sur le socle de la Terre, dans la grâce de chaque instant, je n’ai pas à juguler sous moi des monstres, ni à faire accueil avec mon front haut à des anges. De mon corps, je sais la vie et la mort, l’innocence et la fermeté, la joie et la douleur inscrites dans cette chair où s’est insufflée l’haleine bienfaisante de la création.
La solitude ne m’abaisse, ni ne me hausse, dans ma condition heureuse. Elle me fait, comme mes tissus, mes muscles, mes humeurs me font. Je suis respirant dans le salut de ma chair, dans sa sainteté. C’est pourquoi la fange de ce que l’on dénomme le péché n’a aucune attache avec les circuits nobles que font mes veines le long de mon corps. Et que ma solitude s’ébroue dans la joie peuplée d’univers, ceux des nervures d’une feuille, d’un débris de silex, d’une écume de lumière, des picotements de l’eau du torrent.
Je ne renonce à rien, à aucun signe des choses et des êtres, ni surtout à rien de ce que je suis. Il me faut mon entièreté d’homme, ma plénitude d’homme en joie de vivre, en mal de mort, il me faut ce système de nerfs et de sang, cet appareil de jouir et de souffrir, cette chair à plaisir et à douleur, et que rien ne me sépare de tous les fragments d’images de la création et de son esprit, dans cette région d’authenticité naturelle et commune qui est nôtre.
Jamais en moi cette hantise pour échapper à l’univers, afin de me bâtir un château au fond des eaux ténébreuses qui ne sont pas celles de la grâce. Il n’y a pas d’absurdité dans la vie, et il n’est pas vrai que des terreurs l’entourent. L’aspect ultime de la réalité est simple, humble, et proche. Que je l’invoque par le mot juste, par son nom vrai, et elle est la, elle apparaît, docile.
La réalité, pour contradictoire qu’elle soit, est toujours réconciliée dans mon être. L’absolu ne domine nulle part les a-pics de ma vie. Pas de nuit d’épouvante où m’enfoncer pour aller à la découverte de je ne sais quelle révélation promise. Je ne suis ni un vaincu, ni un offensé. Ce n’est pas pour le silence que je suis ici, pas plus pour une justification ou pour adhérer à une vérité. Mais pour une vie qui ne porte aucun nom, la plus commune, la plus quotidienne. Elle ne peut être là où il s’agit de pensée personnelle. Mais là où il y a une activité qui ne m’approprie pas, une activité vouée à autrui, sans même qu’il y soit attaché un sens de dévouement ou de sacrifice…
Article suivant — L’heure présente du monde