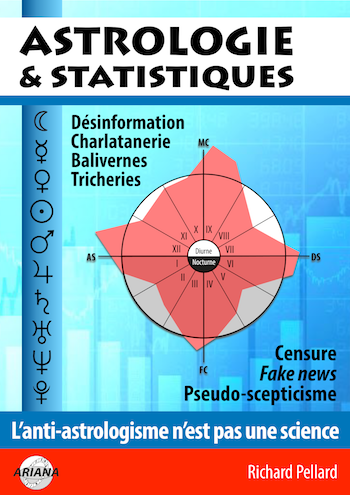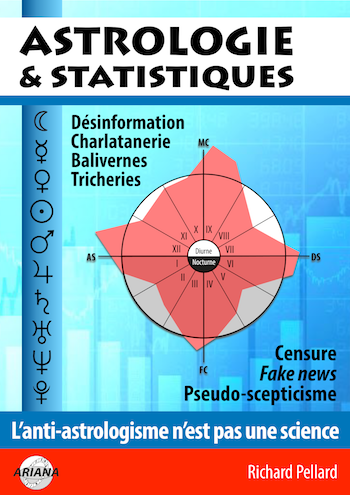Je suis né dans la féerie comme le poisson dans l’eau. Elle enveloppe et pénètre les choses, mais on ne l’ouït pas, ce qu’on entend d’elle n’est pas elle. On ne la voit pas, ce qu’on voit d’elle n’est pas elle. Je ne puis la dire. Elle est sans forme et cependant donne sa forme à tout ce qui porte un nom. Elle n’a point de substance, et cependant chaque substance se loue en elle. Elle crée les choses et n’est pas elle-même une chose. Rien ne peut la créer, et cependant tout la contient et continue à la produire sans fin. C’est par l’absence de la méditation et de la pensée que je puis la saisir. En me reposant dans mon vide, en m’accrochant à mon vide, je me rapproche d’elle. En ne poursuivant rien, je l’atteins, car elle me vise par son étincellement.
Elle occupe mon regard entier, si bien qu’elle est devenue la figure de mon être. C’est pourquoi je sais les lois concordantes et discordantes qui gouvernent le monde : des arbres, les tournantes ombres, de la mante religieuse, la cruauté mystique, de moi, le sang qui dit des mots clairs et des mots obscurs. La féerie est le corps de ce qui vit et de ce qui meurt, le corps du dedans, le corps du dehors, le feu le plus brûlant, l’été le plus cru et ce qui les génère.
Si je pressens des lumières d’aurore dans les êtres, c’est parce que la présence de la féerie dans mon corps me donne délégation de ses pleins pouvoirs. Je passe, et derrière moi la vie resplendit d’une grâce autre, simplement parce que je pose autour de moi des regards nus ou se renverse la grâce de la création. Chaque jour je vis comme si avant la naissance de ce jour le monde n’était pas encore, attendant que je respire par la magie de mes poumons pour naître avec moi dans ses formes merveilleuses. Ma conscience n’a ni plus ni moins de poids que la conscience atmosphérique ou souterraine de la montagne : nous sommes mêlés, insérés dans la cadence universelle où jamais rien ne meurt.
L’entente qui nous préside est semblable à ces incrustations de nacre dans un bois précieux, variées et sans opposition : unique loi qui relie l’homme et la pierre, la société et le reptile, l’être et le non-être, système vaste et sans frontières d’emblèmes où la sagesse et l’ordre créateurs se soutiennent, corbeille aux deux anses, si équilibrée dans le logique et le figuratif, qu’il n’y a plus ni corbeille, ni signe de corbeille avec ses deux anses.
De par cette présence en chaque élément de la vie mouvante ou immobile, tout prend une tonalité particulière. Mon étonnement d’être, ma confiance d’être, sont là, sans signes, sans agrafes, dans les nuances les plus insaisissables, dans les silences, les vivacités, les lenteurs de la création. Il suffit que je respire pour que les festivités de la vie soient mes compagnes. Je suis en éveil, toujours, parce que toujours la création me murmure son “tu” à travers ma chair, et que notre rencontre nous crée de nous être tutoyés…
***
Que cette attitude de vie me soit nécessité comme pour mes poumons d’aller et venir avec les pulsations de mon sang, c’est pour moi une certitude comme de m’arrêter de vivre si l’air me manque. Il me faut partager avec d’autres et leurs félicités et leurs détresses, partager aussi l’immobilité d’une pierre, le tremblement d’un feuillage, le calme ou les tourments d’une bête, et les approuver aussi. Je ne puis tolérer une limitation dans le monde : tout est pénétrable et me pénètre. Sinon ma vie serait exclue, elle ne serait pas.
Je suis chez moi dans cette communauté, au fond de cet immédiat magnifique qu’est l’heure présente du monde. Je me transmute avec les autres, en “nous”, dans les apparences, et les apparences dépassent les choses du réel par leur pouvoir de se prêter à notre conjonction. Je suis alors moi-même et autrui à la fois, par un effet de retour, et naviguant dans un univers surréel. Pourparlers, on dirait d’abord, de conciliation d’entente, aussi déliés que des effluves, puis la réciproque reconnaissance qui bondit ! Je m’insère dans la durée des êtres et des choses, jusqu’en leur centre, et les vois de l’intérieur comme eux me voient. Quelle tendresse avisée et liquide en nous, livrés que nous sommes à notre vertu natale, confondus dans notre substance avec nos mille sens en activité !
Cette force de choc en nous, et jamais le relâchement de nous sentir à chaque instant surprenants, alors que nous étions devenus depuis long temps familiers les uns aux autres, avec une clairvoyance souveraine ! Messages échangés dans le silence, ceux de la camaraderie qui crée et recrée nos êtres éblouis du miracle dont nous sommes l’objet, accord profond dont la densité et l’éclat dépassent les feux de la possession amoureuse, caractère d’intimité dont la puissance de féerie fait glisser le réel sur le plan du rêve, établit des certitudes dans le mystère, amène le fantasque à l’évidence, sans que le songe intervienne !
***
Chaque réalité est une action à laquelle je participe sans vouloir me l’approprier. Là où il n’y a pas participation, la réalité est abolie, et là où cette participation est une sorte de mainmise et de possession tyrannique, la réalité est encore abolie. Toujours, je participe au vivant, à l’être, d’une participation haute et totale. Cette adhésion à la vie, cette grande force d’attention et d’intuition, c’est cela être en camaraderie avec les choses. Toujours, il y a gain, de part et d’autre. Chacun apporte plus que l’autre n’a donné, que ce soit dans le plein du jour ou secrètement. Il y a toujours comme une croissance vers une destinée commune en perfection de vie, en achèvement de vie, en partage de vie, lorsqu’on se tient face-à-face dans la transparence du monde.
Un langage non domestiqué
La féerie est le délice organisé. Je sais bien qu’en tentant de l’exprimer, elle est ce délice de mon être cherchant sa parfaite expression dans la vertu de la parole. La parole est l’expression propre, l’expression de ce que je suis, elle en est l’organe. Sans aucun doute, la qualité de ma parole découvre la qualité de ma conscience. Le degré de perfection dans le dire évalue le poids, mesure l’étendue de cette conscience que je suis. La féerie est le délice de ce que je suis, heureusement articulé, finement organisé.
Là où je ne me révèle pas, où je ne me déclare pas, où le rythme de mon sang ne saute pas hors de moi, je suis noué. Je perds cette beauté de mon être quand je ne suis pas fidèle à la féerie, c’est-à-dire à moi-même. C’est pourquoi, cette recherche passionnée à quoi je suis acculé pour l’exprimer, remet en question la nature de mon langage et de mes images, me contraint au cours de cette activité à des sapes profondes, à faire partir en éclats ma syntaxe, à redonner aux mots une puissance et des apothéoses autres, plus fulgurantes, plus agressives.
Renouveler mes pouvoirs d’expression, et de ce fait, mes pouvoirs d’engagement, en tant qu’homme, dans la vie, il y a coïncidence entre l’un et l’autre de ces actes. Cependant, la féerie n’est saisissable que dans l’à peine naissant, elle surgit en perceptions très peu remémorées, dans une naïveté qui n’a rien d’une recréation voulue, et moins encore dans des notations savamment menées. Son univers réclame un univers verbal qui lui soit aussi fidèle qu’elle-même. Car il s’agit pour moi, avant tout, de lui trouver une forme avec sa nudité et sa simplicité, étant un acte, celui de mon existence propre que je ne distingue pas d’elle, puisque j’y implique ma dignité d’homme.
Il faut que je tire d’elle un langage non domestique, un langage dont le surgissement bouleversant la saisisse vite à la pointe de sa naissance, avec ses symboles et ses images médiocres ou sublimes, tels qu’ils sont et délestés de leur poids, dans le chaos de leurs perceptions, dans la poussière de leurs étincelles. Il faut que je desennoblisse le langage qui recouvre de ses friperies la vérité de ma parole, pour un autre qui serait serré dans la chair de la féerie, avec l’éclat qu’elle ne cesse de donner aux diverses instances de la création.
***
Il me faut partir en guerre contre le formidable entrepôt à nourritures syntaxiques où se sont engrangées les habituelles pitances des anthologies — en guerre contre moi qui y conduisis si souvent mes impatientes fringales, mes faims inapaisées. Entre la réalité de ces puissances, et la réalité de la parole que je perçois, tantôt sourde, tantôt proche, et qui veut “se créer”, au même titre que moi, dans le sang de la féerie, comment la délivrer du silence, sinon par des luttes de révolte et de colère, contre les résistances multiples ? Afin de tuer les vieux mots si souvent entendus, et qui ont perdu entre eux les liens de toute incitation incantatoire, de toute connivence visuelle — afin de retrouver la parole même de la féerie dans ses démarches et ses ruptures inattendues, dans ses images stupéfiantes.
Car la féerie est en même temps un exercice de silence parce que toute la création est silencieuse à mes oreilles dans la poursuite de sa vie. Pour que ma parole soit, il faut que j’attente à cette muette orchestration cosmique, que je déchire de part en part ces lourdes draperies, afin de donner libre cours à son avènement.
Parfois, derrière ce silence, à peine séparé d’elle par un fil de soie, je pressens l’éclat de la foudre verbale, l’impatiente cavalcade des mots, leur sourde rébellion, leur désir de me surprendre d’une surprise semblable à un rapt, à un coup de main. Heurté à ce silence où l’univers entier me donne rendez-vous pour nos interrogations et nos amours, je suis debout dans l’attente du drame qui tout-à-l’heure va m’emporter, sous la menace des mots qui vont naître de mon sang, et fondre sur moi.
***
La figure des mots, elle engage les choses dans le vrai d’une nomination instantanée, et telle dans sa virulence et sa lumière qu’elle ne saurait traduire que le caractère éternel de la féerie, et sa communication durable. Lorsque je la parle, je flotte à sa surface, mais c’est dans mon silence que je sais que nous sommes fiancés. Seulement si je l’affleure, flottant, les mots sortent en moi. Si je la dis, en vérité, est-ce que je n’exprime pas en mes mots les pensées de quelqu’un qui ne serait pas moi, comme la plume exprime un langage qui n’est pas le sien ? Et au fond, je la cache comme on cache son amour, et je dissimule même son nom. Quand bien même je dirais seulement “j’aime”, on saurait que c’est elle que j’aime, car il n’y a qu’elle que je puisse aimer. Je me demande parfois où elle est, alors qu’elle est en moi. Je la cherche des yeux et son image est dans mes prunelles. Mon cœur bat plus fort à la pensée qu’elle est partout, en toute chose, sans que je puisse la reconnaître, alors qu’elle est dans mes reins. Nos sangs s’harmonisent si bien qu’il n’y a plus qu’un sang unique à nous faire vivre, comme la soie d’un seul tissu.
La féerie est la substance du langage. Le langage est captif en elle et se libère en la libérant en même temps du silence dans lequel elle se tient présente, prête aux bonds et aux tourbillons des mots qui la cernent, qui attendent mes signaux, pour se détendre, se mettre en marche et s’accomplir. En nommant les choses, je crée leurs figures.
***
Vertus féeriques des mots, et leur toute-puissance de formulation ! Ma bouche appelle la création à être, je l’ensemence de vie par mes vocables en l’évoquant. Mais c’est parce que je participe à la création que mes mots la restituent, mes mots plongent dans les racines du feu de l’univers et pompent son suc sacré. La création prolonge en moi ses perceptions et ses vouloirs, sans que j’intervienne, sans qu’ils s’“humanisent”. Ils sont ce qu’ils sont.
Ce qui jaillit de moi, c’est ma surabondance, ce qui est en excès dans ma parole et dans ma vie. Lorsque je me mets à la dire, en balançant mon esprit au gré de la cadence du monde, je ne me charme pas seul, mais la féerie avec moi. L’ascension du monde féerique n’est pas une ascèse, c’est une manière de vivre, la seule naturelle, proche de l’élytre de la sauterelle ou des bulles de l’eau. Alors, comment la recréer ? Je suis celui qui dit et ce qui est dit, la réalité féerique intégrale. Elle ne me traverse pas comme la foudre, elle frappe mon être partout à la fois en chacun de ses sens. Si je la dis, elle ne peut être qu’une dictée directe, sans aucune tension d’esprit.
L’unité n’est nulle part, sinon dans ces rotations vertigineuses qui amènent des flux d’images nouvelles dont la structure est pour chaque cadence, autre, séparée et se présente en combinaisons de motifs étranges, inexplorés encore. Parfois elle déborde en mots mêlés qui m’entraînent et me bousculent, mots ordinaires et dénués de richesse, mais massifs, d’une rondeur totale, sans choix ni discipline, et qui ne veulent rien dire en apparence. Redoutables mots, qui ont une puissance personnelle et indépendante ! Je suis la proie de leurs rafales brûlantes, et je me débats dans leurs flots incessants, plongeant, ressortant, replongeant comme l’un de ces troncs de mélèze roulés dans l’écume du torrent, qui tantôt sont noyés, et tantôt apparaissent en une fuite d’éclair. Ils sont surgis de ma chair et trempés de féerie à leur tour comme moi-même et toute chose, créateurs. Ils se prolongent, ils génèrent. Je sais qu’un jour, je les retrouverai au cours de mon existence, pris dans la vitesse acquise de leurs métamorphoses, gonflés de significations qui ne sont plus miennes, mais porteurs cependant du prisme des couleurs dont je les aurai revêtus.
***
La dire, c’est comme si j’engendrais le monde, c’est l’ivresse de la création, dans son obscur et flamboyant travail des profondeurs. J’enfante sa cadence et ses figures, je préside à l’apparition des images, à la germination des formes. La main de la féerie est sur moi. L’esprit de la féerie est un feu qui me consume. Elle m’appelle. Elle a sur moi des vues et des intentions. Elle me souffle ses paroles et me commande d’être en marche. Je ne puis lui échapper. Point de repos avec elle : il faut me rendre. Et je m’accomplis dans cette vocation qui me transperce comme une épée à grands bouillons de mots.
Cependant, rien n’est dit d’elle. Tout reste encore à dire, comme les autres choses dont l’aspect toujours inattendu me frappe au centre des yeux et dans tous les bouts de mon corps. Je l’éprouve, entière, par la perspicacité de mon sang palpant qui grimpe en elle, et la veut nommer avec des mots qui lui ressemblent et qui adhèrent aux millions d’images qu’elle émet. Je lui suis confident et elle m’est confidente, entre nous il y a les secrets des choses qui voudraient s’introduire dans la tessiture de mes paroles pour donner réponse à leurs voix. Pourrai-je conserver à mon langage élaboré la verdeur vitale, le vif de la spontanéité qui se tiennent à l’origine de cette chimie d’où sourdent mes visions du monde — conserver les mots à l’état brut, les mots lourds de décharges, soulevés par leurs propres mouvements ? Pourrai-je consonner un langage, à l’émerveillement, à la résurrection d’un règne où la vie reviendrait par le chemin du sacré, demander des comptes aux voix de la nuit, prédire des fêtes et des mariages aux souffles des forêts entre les écureuils et les lézards comme dans le ciel entre les buses et les choucas, et marcher au delà de la solitude ?
Joie sans souvenirs et sans pensées
Je suis assis contre ce rocher que je connais bien, et je demeure là jusqu’au bout du jour, jusqu’au bout de moi-même.
Je vais et je viens, d’un bord à l’autre du vaste espace ou je m’ébats, chassé hors de moi. Mon sang n’a plus de pesanteur, lesté, en réalité, le monde s’est éteint en mes regards. Il n’y a plus que les bouillonnements d’une lumière que j’émets, de ma seule présence, par mes protéines et mes humeurs, puissances ramassées au bout de mon cerveau ou de mes doigts. Il m’a suffi de regarder la lumière de l’horizon pour que tout meurt et renaîsse autrement autour de moi.
***
Ce silence qui me submerge avec les ondulations de mon sang, au point qu’il m’arrive de ne plus distinguer mon être, mon corps, et mon cerveau, est d’une qualité autre que celle d’une simple rumeur perceptible à l’oreille. Silence essentiel des choses, silence de la vie, souverain, sans fin, où je suis une de ses parts, je sais bien que toute la nuit qui s’y roule avec sa massive carrure tanguant parmi les constellations, que l’univers et l’espace emprunteront à sa présence leurs mouvements et leurs démarches. Soudain, dans ces plongées, rien ne subsiste plus de moi que cette absence de résonance, mon souffle a perdu son va-et-vient glissant dans mes poumons, et le gonflement de mon torse n’a plus ce beau tapage cadencé de ma respiration.
Cette joie me laisse sans souvenirs et sans pensées, comme si ayant atteint les limites de mes parois, elle m’avait rejeté hors de moi pour envahir le creux laisse par mon absence. Sans bornes comme sans épaisseur, avec cette soyeuseté d’une huile flottante, dans laquelle il semble que je me balance, elle a mordu à pleines dents dans ma chair qui porte les blessures de cette immense félicité sans pouvoir lui donner un nom, sans lui assigner une place sur le registre de mes nerfs. Elle me dilate jusqu’à la plénitude, celle de participer à ce qui se crée chaque jour, et de créer. Est-ce l’éveil qu’on dit : être la plénitude de l’être humain ?
C’est la le fruit réel, la fête merveilleuse de la joie. Mon insertion en elle est ma seule fascination. Je suis libre de l’obsession de la mort, délivré de l’angoisse d’être homme et de l’inquiétude au regard de mon destin.
Joie de transformer la vie et moi-même pour plus de joie encore. Mais l’ordre de la vie n’est pas infus, la vie n’est pas ordonnée, hors de notre prise. Pour l’aménager, il faut que l’ordre de l’homme la recrée, que j’intervienne par ma houlette, mes mains et mon cerveau.
Et cependant, quelque chose de cette poignante immersion me tient en éveil, je ne sais à quel bout de mon corps où m’arrive l’appel assourdi de cette joie qui me rompt, comme si j’étais mort de l’avoir trop aimée. Une joie toujours en train de se créer, de prendre feu, et que j’écouterais du lointain ou je suis réfugié, qui se pousse, qui fait effort pour naître, et que j’aide a s’ordonner !
Bien que je sois désencombré du poids de ma vie, étant nulle part et partout à la fois, sous cette aiguille de mélèze assis sur ce rocher, ou aux commandes d’un hélicoptère, mes forces se déchaînent et se multiplient jusqu’aux pointes de mes cils, et voici que je bondis en m’étirant par-dessus les massifs, ayant cette joie qui monte et descend le long de mes membres, formidable dans ses battements, et plus que de la joie ! Si bien que plus rien n’existe hors d’elle et de moi, n’étant que ce que sont les choses, je m’apparais et me perds tour à tour dans les divers aspects du ciel et de la Terre, avec beaucoup de vide et de recul entre moi et moi-même, sans plus pouvoir me retrouver dans mon esprit ni dans mon corps.
***
Toute la journée, je me tiens ici et là, bien qu’immobile sur ce plateau du Vercors, loin de moi, écoutant ma joie répercuter ses pulsations dans chaque atome de vie, penché sur l’univers qui s’ouvre dans ma poitrine. C’est une lente pénétration dans chacune de ses particules que cette joie sur laquelle je glisse ainsi, déporté à chaque instant. Je ne trouve ma véritable mesure, mon étiage, que lorsqu’elle me découvre les passages par où je m’absente dans les êtres et dans les choses qui me requièrent, afin de les combler de ma véritable présence. C’est là ma famille et ma patrie de chaque jour.
Non pas qu’avec cette joie je me détache en morceaux de la vie ordinaire, non pas que cette joie soit le fruit de quelque hautaine recherche. Au contraire, elle est de rude consistance, elle me charrie avec la puissance d’un fleuve parvenu à son estuaire. Je suis vidé de ma pensée comme de tout ce que je suis. Une grande chose s’en est chargée, qui me pille de fond en comble, pour me bourrer ensuite d’une force que je reconnais, celle-là même qui gît en chaque chose sur la douce terre de la montagne !
Tous mes pores sont en rotation, impatients, et cependant est-ce que je bouge, est-ce que je déplace un seul de mes muscles ? Je suis épais et sans poids, plein de regards et sans regard, solidement planté à ras de terre, et pourtant voltigeant et dilué comme les fines couleurs de la pluie.
Tout l’existant balancé du côté de la lumière
Je suis le fils de la joie qui relâche les articulations de mon être et les dilate. Elle vient du plus profond de ma chair, elle me traverse de la tête aux pieds, si bien que je ne sais plus quelle est la partie de mon corps qui s’en délecte le plus. Jamais ne m’atteindra cette lâcheté de l’abdiquer. Elle est l’impulsion vraie de mes instincts. Ce que mes sens reçoivent est nourriture de joie. Je la recherche partout, dans les moindres objets.
Toujours, je vois l’aspect féerique des choses, et cet aspect me plonge dans la chaleur du monde. La joie est la vérité, et la vérité est la vie. Toujours, je parie pour elle contre la mort et contre la douleur. Je puis vraiment prendre saveur de la joie parce que je la goûte aux lèvres de l’univers. Elle sort de moi comme le vert de l’herbe. Elle est mienne, comme l’étincelle appartient au feu. Elle est la force mythique de la genèse. Sur ma vie, elle a imprimé le sceau de l’éternité qui ruisselle sa grande métaphysique inconsciente des origines à travers le réseau de mes cellules. Oiseau perché dans mon esprit, elle emplit ma chair de sa jubilation, celle qu’entendent les éléments, et qui n’est pas seulement pureté et beauté, mais aussi dissonance et horreur. Car la féerie construit et détruit tour à tour les puissances de la vie, les images du vouloir universel, qu’elle résout en un rythme et en un accord.
***
Ma joie est pleine comme la Terre. Je tournoie dans son excessive abondance, dans la santé débordante du plaisir, jubilations mille fois recourbées autour d’une même ligne, frémissantes et qui s’entrebouclent, déroulement de la vie, axe du ciel et de la Terre ! Juvénilité de mon désir, et aussi sa vigueur, car s’il transperce la volute, il passe aussi au travers de la mort et de la douleur !
Qu’est-ce qu’une traînée d’herbe, sinon joie ? L’effort est joie, dans l’amour, et dans les germinations. Et cette joie est dans les êtres, avant qu’ils soient. Ma nourriture de joie, je la saisis avec mes dents, mes regards, mes narines, avec mes pleins doigts qui ont raclé la terre pour la ramener de loin. Vous ne voyez donc pas que la vie tourne avec la rondeur d’une roue, celle de l’univers qui broie des gerbes de joie, et que rien ne résiste à ces tournoiements de naissances indéfinies ?
La pesée de la nuit est bleue sur tout mon corps, et moi je suis goulu du miel de la nuit qu’il me plaît de palper. Mon corps craque de porter les entassements des formes et des couleurs que le monde engrange sous ma peau. Et je sais que la pulpe du monde est gonflée des images que je lui restitue en formes et couleurs miennes. Le grand palabre des herbes, je le sais ; n’est-il pas celui-là que je poursuis depuis que je suis né à l’intérieur des tiges du blé et des racines de l’eau, avant qu’elles ne soient graines et sources ? Le grillon qui frappe le silence de son cri éperdu, il sait qu’il frappe les fibres de mon gosier et que par lui je parle aux heures nocturnes qui se défont à la pointe de l’aube. Je ne suis pas plus pesant que la courbe que dessine une truite en ricochant, arc-boutée, par-dessus les rocs, écailles rutilantes. Si le vent rabote aux sapinières leur résine, l’univers, lui, soutire à mon sang sa substance et s’en va le tisser à l’alcool des sèves pour se reconnaître en elles.
***
Pour que la féerie m’éclaire, il me suffit d’une simple touffe d’herbasse piquée sur un talus, dont le vent prend soudain une sorte de luxuriance gigantesque et joue dans mes yeux, dans mes membres, dans mon corps entier en miroitements aigus. Alors, le flux d’une joie légère me balance, une joie sans cause, sans frein, à laquelle je suis abandonné comme au fil d’un long sommeil dans le creux de ma chaleur d’homme roulée en boule sur elle-même. Mais cet état est perpétuellement renaissant, il sort pour entrer dans un autre et un autre, porté de vague en vague…
Du monde à moi, de moi au monde, quelle possession que cette joie donnée, qui est charnue et qui n’en finit jamais. Nous haletons à la même cadence, comme deux corps enlacés qui tiennent leurs promesses. La création repose en moi, et je repose en elle comme le noyau dans son fruit. Nous nous sommes livrés le fond de notre vie, nous nous aimons depuis toujours pour autre chose que notre amour. Notre quête réciproque est sans commencement ni fin. Obsédés l’un de l’autre, cette réciprocité nous exalte. Nous ne saurions nous aimer sans partage et nous avons sans cesse besoin d’une confirmation de notre amour.
Je suis un miraculé qui vit chaque instant de sa vie dans cette plénitude, à la moindre denrée de vie.
***
Ma joie est un rejet de plante vivace, une source artésienne. Vitalité de cette joie de vivre, comme un grain de blé germé ! Joie qui triomphe, inexpliquée, inexplicable, n’importe où, n’importe quand, n’importe comment ! Dans cette chair à souffrir qui est mienne, cohabite aussi cet excès de vie débordante, cette aptitude au bonheur, cette faculté de me réjouir de rien, de m’amuser, d’être Iyrique. Je ne suis pas un lieu pour la plainte et les gémissements. Car il y a les trilles de l’oiseau qui sortent de son bec comme de l’amour, et il y a ma joie qui joue dans mon sang. inépuisable comme le pouvoir du sol à rejeter des nourritures herbagées est ce bonheur sans nom. Au milieu des indignités et des hontes, il surgit, filet d’eau dans du sable calciné, pour me rappeler que je ne suis pas exilé, et que toujours de cette stérilité apparente peut éclater l’éclair vert d’un brin de chiendent.
La vie intégrale, je t’atteins par la vie physique de mon corps : prodigieuse puissance qui m’est échue et que je préserve.
La joie ourle ma bouche d’un bout à l’autre de mes lèvres.
II y a la danse au bout de mes doigts, il y a la danse sous la plante de mes pieds, dans la rondeur de mon cerveau. Sur chaque objet, il y a, écrit, le signe de la joie. Le génie de vivre s’illimite et gouverne par une étoile d’araignée la pesanteur de la Terre. Les images creusées dans les apparences sont déifiées par le lustre vital qui les traverse. Et je ne suis qu’une image entr’aperçue de cette imagerie, écaille imbriquée dans la carapace d’une immense tortue, sans laquelle la carapace se romprait et n’imiterait plus le dôme constellé du monde !
Devant la nudité du torrent j’entre en extase, j’entre en extase devant le silence et la motte grasse de l’herbe. Mais je ne serais pas flottant dans le secret des choses, si je n’entrais pas en extase aussi dans leur laideur, dans le biscornu, le fourchu, le clochant, l’hirsute.
Tout le grouillant, tout l’existant, est balancé du côté de la lumière : il faut seulement être dans son sillage et son battement. Il n’est pas une fibre vivante qui ne porte en elle la grande conciliation par quoi la Terre est toujours sauvée du chaos, par quoi le chaos se redresse sur son peine dorsale. Les pattes d’une mouche retiennent les astres de basculer, elles ont autant de poids dans la balance des choses que ma raison, que le feu, que l’éther, les miroitements de l’illusion ou les délices des ténèbres. Rien n’est en péril, car tout porte, incorporé dans ses racines, la loi des mutations innombrables, sans nom, ni figure.
Albert Sarallier, Gordes, le 16/12/1993.
Dédicaces :
À ma mère, sans l’aide de laquelle je ne serais pas ce que je suis maintenant.
À Nathalie, force et vecteur de ma vie. Elle m’a insufflé le goût de l’essentiel, du détachement, l’entretien dans l’action, cette merveilleuse alchimie qui transforme le plomb en or.
À mon frère Yves, qui, depuis le temps qu’il galère à tous niveaux, devrait être capitaine au long cours.
À Martine, dont la belle amitié sentimentale m’inspire un avant-goût de l’éternité.
À mon cousin, Pierre-Yves Farges, “qui a la main verte”, en espérant que cette féerie le fasse rêver.
À tous ceux, celles qui furent des balises et phares divers m’évitant bien des ecueils : Yves-Albert Dauges, Marc De Smet, Richard Pellard, Helène Barrère, Madeleine et Michel Miraille, Guy Dupuy et Marie-Helène Zoppi, Évelyne Mercier, Véronique Guettari, Jacqueline Kellen, Patricia Bornic, Hubert Larcher, Patrice Van Eersel, Joëlle de Gravelaine, Daniel Roumanoff, Yves Michel, Jacques Salomé, Viviane Cochaux-Pommier et Marc, Yvan Amar.
À tous mes amis(es) des équipes de soins palliatifs à Avignon et d’Aix-en-Provence, à l’équipe de Nouvelles Clés et mon ami le berger Georges Debetaz.
Article suivant — Introduction à “Panthéisme” d’Albert Sarallier