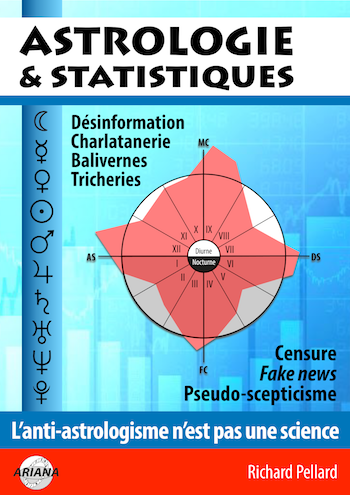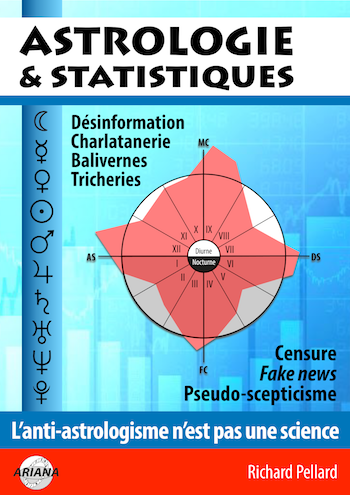Le centre de ma joie est bourré d’amour, comme la pâte du fer est bourrée de feu. Mais cette joie n’est pas uniquement mienne. Mes yeux, mes oreilles, ma peau, ne se plaisent pas d’être pour moi du plaisir, ils sont de chaque palpitation de vie du monde. L’édifice de mon corps avec ses sécrétions, son phosphore, son sang, demeure ouvert aux houles des autres vies. Si une part de moi se trouvait frustrée de sa provende de joie, c’est qu’elle ne se serait pas donnée entièrement.
Terres accordées de la féerie où ma joie s’offre à tous ! Ah ! que nul ne se prive d’y puiser, que nul n’attente à cette festivité ! Pour me sentir en plénitude heureuse avec la création, il me faut m’assurer d’abord que les autres le sont. Tout ne se tient-il pas, comme les cinq doigts aux jointures de la main ?
Je suis né des autres et non de moi. Réduit à ce mince anneau de mon être, il ne me resterait rien de la joie, qui ne devient joie qu’au moment où elle est partagée. Pour orner ma vie en ampleur et en élévation, j’ai tout tiré des créatures et du cosmos. Je n’ai rien qui m’appartienne de mon propre fonds, ni la pensée, ni le rêve. Bouclé entre les barreaux de ma secrète joie, je serais le voleur qui dépouille les autres et serre contre sa poitrine son inutile larcin.
De la joie d’autrui dépend la mienne. Devant le bonheur des autres, le mien se concrétise. Je ne puis en goûter d’autre, je n’en connais pas d’autre !
Je n’élèverai jamais ma vie aux dépens de celle des autres, en passant par-dessus leur joie, pour la refouler et m’y installer.
La joie qui prend son élan sur la calamité et sur la honte, comment pourrais-je l’accepter ? Si mes chaussures dénudaient les pieds d’autrui, j’irais pieds nus.
La joie est un acte où tous doivent prendre part.
Etre seul dans la joie est monstruosité. Plus besognant, plus dur il est d’être debout au milieu de la joie du monde que d’avoir long visage et se tenir en tristesse. Et je secoue autour de moi cette alacrité hardie, cette puissance gaillarde de mon sang, afin de donner aux autres l’image de mon bonheur, et qu’ils la suivent, la connaissant, et la partagent.
La joie ne se divise pas contre la joie. Elle coule comme une eau qui va, et elle grandit en force comme une eau qui vient. Certitude, te voici, orage abattu sur moi, au delà de mon regard, de mon geste, de mon visage, la joie est là !
Je ne perçois pas cet être invisible de couleur et de consistance, mais je me sens dans sa proximité, et il y a une place occupée par lui dans ce que je suis, respirant, mouvant. Quelque chose qui se dissout en moi, délicieusement, jusque dans ma propre matière qui est fluide, si bien qu’il ne me semble pas extraordinaire de voir s’échapper le sang de mon cœur à cause de cette brûlure sans nom.
Joie de chaque instant, sûre, égale, parce que chaque instant ne s’étaie que sur ses présences innombrables attirées autour de cet amour, et que le maintien de ma vie dans sa plus humble nécessité ne s’obtient que par un constant abandon de moi-même. Joie si perpétuellement présente que je ne vis pas un seul moment hors de son empire. Je ne la sens pas seulement dans mon sang, mais hors de lui, rejointe par la joie de l’univers, beauté et lumière mêlées, que nulle forme ne précise, qu’aucune parole ineffable n’articule !
Elle n’est pas une révélation fulgurante, mais l’amie, l’amie en toutes choses. Toi pour moi, moi pour toi, mais là où toi et moi ne nous distinguons pas, où nous ne pouvons jamais souligner notre identité séparée. Ainsi sommes-nous sans limites, puisque les limites sont brisées autour de nous.
***
Je me délie dans la beauté végétale qui s’édifie en feuilles, en tiges, en fleurs. Elle est l’exact reflet de ma joie, car ne s’est-elle pas tendue vers moi du milieu de mes racines, ne m’a-t-elle pas reconnu, comme on n’arrive au cœur du dattier qu’après avoir traversé plusieurs enveloppes de fibres. Je suis l’eau de la source mêlée au fleuve. Et je roule dans une tranquille inondation de paix. Aucune instabilité dans ce rythme qui enfle et décroît comme ma respiration, en nappes ininterrompues. Tout est égal, à l’image de cette immobilité d’eau, qui cependant s’écoule. Et pourtant, dans ce ravissement et ce balancement inéluctables, je sens mon aspiration brûlante qui voudrait tendre davantage les cordes de mon être où résonne ce chant débordant, et pousser le fleuve au-delà de lui-même, jusqu’à la mer.
Joie d’exister, surprise d’exister : la minute qui fuit le dit à celle qui va la suivre, et je suis chacune de ces minutes en allées… Je suis le contenu de ce que je vois, de ce que j’approche. Comme mon corps contient mon sang qui en est la gerbe et le lien. Je suis donné à ce qui est toujours, et je réponds au vocable créateur, le “nous” de l’immensité. Je ne parle pas un langage en mon propre nom, mais au nom de toutes les créatures associées à moi, rencontrées en moi. Cela est à peine une touche, un tremblement de rosée, une étoile filante, et cependant est permanent, renouvelé sans fin. Cela baigne mon corps et n’est pas moi, cela travaille dedans moi jusqu’en mon sommeil et me vient du dehors. C’est la charpente de mon squelette et sa chaleur, et ces doux volumes de chair répartis sur mes os, et pourtant c’est venu d’ailleurs modeler la forme de cette redoutable puissance qui fait que je suis mille millions d’êtres.
Tout ce que je touche se crée dans mes mains. La source ruisselle dans mes bras, l’arbre se renverse dans mon corps, les braises du Soleil s’éteignent dans ma bouche. Je suis dans la création comme l’homme et la femme qui se rejoignent. Je dépose ma forme dans la chair de chaque créature, cette forme qu’elle-même a provoquée et qui porte son effigie. Tout s’est servi de moi pour naître. Le feu est en moi comme il est dans la Terre, comme il est dans les verdures ardentes, dans les coulées des glaciers. Mais tout demeure inexprimable malgré les analogies, les similitudes, les figures, les symboles. Je ne puis forcer mon silence et ma solitude où me tiennent société mes bien-aimés. Tout ce qui se traduit s’arrête au bord des paroles, pris dans l’obscurité des paroles : le lait de la suavité coule cependant à travers !
Mon regard est celui de la source
L’univers se chauffe par mon visage qui est le feu. Et chaque poil de ma barbe est une parole amoureuse.
Je suis dans le bois si on le fend, dans la pierre si on l’effrite, dans l’eau si on la puise. Je suis lié par des agrafes aux sortilèges du monde, je fais corps avec eux, j’en ai plein les mains, ils sortent partout de ma vie. Les vents s’accroupissent à mes talons ; des tourbillons de pollens s’échappent de mes narines. Les genêts, qu’est-ce, croyez-vous, sinon mes veines ?
Au milieu des vents, comme un manège, je vire, le cercle du zodiaque avec ses Signes, au fond de mes yeux enfoncé. Les tourbillonnements de la Terre sont les miens, et l’immobilité de la Terre est la mienne. Des forêts, des aigles, des sentiers, tout ce qui vole, saute, rampe, me parcourent sans arrêt.
***
Mon être est inscrit dans le signe de l’arbre, dans les yeux du torrent et la levée de la nuit. La fable de cette féerie est la fable de ma vie. Mon regard est celui de la source, et celui du Soleil veillant au bord des secrets du ciel et de la Terre. Féerie, cela est aussi réalité et matière, féerie jumelle, à mesure de la vie, à démesure de la vie : celle du moulin à café, de la cruche dans l’encoignure de cette cabane, des pommes de terre : objets usuels qui délivrent des messages. Cependant, les fleurs dans ce verre d’eau ne sont plus des fleurs, mais ruissellent de reflets humains par leur chair végétale. La couleur du ciel d’aube tourne à la rose naissante, et que dire du mystère que contient le vol du choucas ?
***
Mon corps est musicien de ses chants d’arbre, de terre et d’animaux, qu’il poursuit avec les psaumes de l’univers. Ma vie prend source aux racines de la montagne. Sur mes lèvres, se joignent les symboles de l’espace, les cercles, les cubes, les parallélogrammes des éternités.
Mes sens transpercent le monde et jouissent en lui. Les saisons s’écoulent et s’interpénètrent dans mon corps : il est des amandiers qui se couvrent de fleurs en hiver, et il est des fleurs qui éclosent sans que le soleil du printemps rayonne. Je vois, et ce ne sont pas mes yeux qui voient, j’écoute, et ce ne sont pas mes oreilles qui perçoivent des musiques, jouées sans instruments, sans doigts. Je me balance à la pointe des hampes que lance le Soleil, dès qu’il fracasse la ligne des crêtes. Je suis toujours délesté, et lourd en même temps du poids de la Terre. Les perceptions qui se tressent en moi sont des réseaux qui rebondissent hors de moi, en miroitement. Il n’est rien qui ne soit transparent dans ma chair, au travers de laquelle le monde rit, et moi je ris au monde.
J’assume la féerie comme une vocation. Me rassemblant, je me dirige vers l’herbe, vers la pluie, la bête ou la racine. Je me concentre avec chaque pièce de mon être, et dans un état de tension aiguë, je lance sur elles la bordée de mon corps qui coïncide et qui s’ajuste à leur génie. Je deviens ceci ou celà, en veillant sur cette lente désagrégation de moi-même en autrui, avec une attention croissante. Et je suis la substance de cette colline sous son feutrage d’aiguilles de mélèzes. Je suis lancé dans la sonorité des choses, de plein fouet, dans leur intérieur fluide, et dans le noyau de leur dureté. Je suis leur frère par le ciel et l’aiglon ; je n’ai plus les regards de mes yeux, mais ceux de la corneille qui voyagent dans mes yeux. Je ne songe plus, je suis songé. Je ne pense plus, je suis pensé.
***
Le cirque de rochers est bleu, et c’est moi. La cabane a un friselis de fumée qui fait jonction à petits bouillons avec l’air miroitant, et c’est encore moi qui me penche au bord du monde. Mon corps est ailleurs et l’animation de mon corps a passé dans celui des massifs qui se ballonnent et se déchirent aux entournures des vallées. J’ai cédé la place à ma propre ombre, et je suis mon ombre, comme je suis la ceinture de cette forêt de sapins, plus sombre qu’une gentiane. La rumeur de toutes les forces qui carapatent à travers les rocs, c’est mon cœur qui est dedans, forant et fouissant. La courbure du ciel s’encastre dans mes poumons et épouse le creux de mes reins. Mes mains sont les palmes des feuilles et les aigrettes d’eaux-vives des torrents. Mes os parlent, droit devant moi, à l’étendue, et l’étendue s’en vient se pelotonner autour des rotules de mes genoux, se frotter aux angles de mes coudes et se renverser au bord de mes cils, dans son ampleur d’espace, transpercée par le dard de ma douceur. Je regarde les prairies dans les yeux, et chaque nervure d’herbe me voit de son plus clair regard qui ne peut pas trahir.
***
La création entre et sort en moi, comme la pointe d’un burin qui va et vient, comme le serpent entre et sort, sort et entre dans son trou. Le sang des choses se déverse dans mon sang, noces royales. La graine du Soleil ensemence ma propre semence d’homme, mais moi, est-ce que je ne fais pas germer à mon tour les semailles dans les labours, par le grand soleil du printemps ? Dans le moyeu de ma vie, virevolte le moyeu de la Terre, l’un et l’autre d’une même nature tourbillonnante.
Tout se rattache à tout. Je suis tout. Tout est moi. C’est une unité sans fin, dans laquelle je suis pris comme une abeille dans son miel, que je capte ainsi qu’elle me capte, et vers qui je m’élance en même temps qu’elle se précipite dans l’amphore de mon corps, l’un et l’autre reliés par nos artères et nos jointures, ayant besoin l’un de l’autre pour nous accomplir.
Ma chair tourne sur ses points cardinaux, sous mes talons agiles. Cependant, quelle immobilité d’une joie parfaite fulgure à mon front et sous mes paupières, sous toute ma peau, comme un feu qui balise le monde. La lumière, en se développant comme un bourgeon, m’explique à moi-même, me dévoile mon identité. Je suis ruisselant dans la création, et elle aussi s’engouffre dans mon corps.
La féerie me tient et je la tiens, nous sommes l’un par l’autre. Chaque jour, je déchiffre sa réalité dans celle d’une fourmi, ou celle d’une goutte de pluie. Ni les dieux, ni les philosophes, ni les hommes de science ne réussiront jamais à m’apprendre l’existence de cette fourmi et de cette goutte d’eau.
Pour les épines on ne coupe pas le rosier, car l’épine est le désir des roses. Etre cette épine est gloire. De même l’écorce des arbres est l’aliment de leur vie. De même, les moindres parcelles de mon être, ma peau et ce qui est sous ma peau, ne font qu’un. À chaque instant, je trouve dans mes bras le parfum de ma bien-aimée, la féerie. Comment ne la prendrais-je pas parfois moi-même dans mes bras, moi qui suis cette féerie ! O ma lumière féerique, lorsque je pose mes pieds sur le dos de la Terre, et que ma raison saisit au vol la réalité de la Terre !
La féerie est ivre de moi, comme le vin le serait d’un ivrogne. Je suis enfanté chaque jour, chaque jour je suis rajeuni, pur et sans coulpe. Mes membres se renouvellent à l’éclat de la beauté du monde, mais il faut demeurer très humble au sein de cette joie !
Les chambres de la féerie
À chaque instant, je prends des ailes, des nageoires, des peaux glissantes de reptiles, des sabots, ou bien d’autres faces humaines, renaissant par des morts et des vies successives. Comme d’une chambre de nouveaux mariés à une autre chambre de nouveaux mariés, ainsi je passe dans les chambres de la féerie. Je mime les démarches de l’amour, de l’aise, de la joie, je les mime parce que je suis en elles, dans leur matrice profonde. Les épouvantes, les duretés, les souffrances quotidiennes sont comprises aussi dans mes identifications. Je les prends sur moi, j’y participe, elles sont mes accomplissements comme la Lune reçoit les reflets du Soleil qui sont encore de la clarté. Jamais je ne suis mis en sommeil dans cette volupté âpre. Toujours, de toute ma chair, je suis flairant, palpant, happant. Jamais je ne me repose, parce que je ne suis jamais arrivé.
L’amour est effort, il est action. Et refais toujours passer ma vie du côté de la lumière à laquelle est cousue sa propre ombre. Je tire mes forces du patient sommeil des racines, des êtres et des choses. Eux, ils plongent en moi leurs trompes et se gorgent de ma succulence féerique, ce feu méridien, drapés de leurs longs désirs de naître à eux-mêmes et à leur nom, crées soudain par la gerbe de mon souffle, cette vertu cardinale qui m’accorde à l’engrenage des sphères et des nombres.
***
Je suis en dehors de moi dans la surdité universelle, transféré parmi les choses muettes, et je ne puis pas ne pas prendre mon parti de la misère humaine ni des réjouissances humaines, car elles existent. Cependant, je suis proche aussi de la sainteté des pierres qui sont obéissantes aux disciplines de la vie. Car le monde minéral est le repos, imbriqué dans la puissance mobile et merveilleuse de la sphère.
Le ciel se cambre, et je sais qu’à cette minute où son bleu a bandé sa rigueur, jusqu’à se rompre, mes regards sont nés aux images. Un vol de corbeaux a battu l’or de la lumière qui allaitait l’aurore, et je sais que les oiseaux, morceaux de nuit et d’acier, se sont envolés de mes yeux, comme mes propres créatures.
Célébration des noisettes dans leur corolle de dentelle verte et leur coquille couleur de bois de rose, célébration des hirondelles sur les fils télégraphiques des bas-pays, aspirant l’espace pour ensuite le cisailler en lamelles, célébration des colchiques dans les prairies miroitantes, célébration de ces graphies nerveuses, qu’inscrivent sur l’azur les découpures des monts ! Je suis devant ces maturités d’automne, ces floraisons, ces vibrations d’oiseaux, ces lignes taillées dans le rocher, à la pointe du mystère des choses, non pas l’être palpitant de ces prises, mais jeté en elles, entièrement passé dans l’amande des noisettes, dans l’oiseau au corps aigu, dans les brins de lavande et les ondulations des pentes, frais de mémoire et de sens…
***
Je suis toujours faufilé à travers les tissus des éléments qui suspendent autour de mon corps des vergers de visions, qui étalent sur mes surfaces des plages de visions, qui m’investissent des formes de l’étrange et de l’énorme de la Terre. Tout est signes dans les apparences comme dans les faits, signes qui ont l’implacable précision des figures géométriques, malgré leur cohue et leur confusion. Tout est accord dans cette féerie et cette commune mesure des aspirations qui ordonnent l’ensemble.
***
Que je sois un brin d’herbe froissé par le vent, et mes membres jubilent, car il n’y a rien qui dépasse la grandeur d’un brin d’herbe ! Qu’est-il comparé à celle d’une chaîne de montagne ? Mais l’herbe et moi, l’univers et moi, nous sommes nés ensemble : ce que contient cette herbe, ce que contient l’univers, ce que je contiens, est un. J’émerge, je replonge dans la féerie, comme un dauphin parmi les vagues. Je me vois un brin d’herbe et ce n’est pas un rêve, puis je me vois un homme et je rêve, et entre l’herbe que je suis et l’homme que je suis, il n’y a pas eu mutation, mais entière identité.
Ailleurs, ma forme humaine a la pacifique sérénité du végétal, avec les hautes tiges de mes jambes, l’évasement de mes épaules et ma figure qui se balance au sommet de cette tige miraculeuse qui bouge comme la fleur du tournesol. Je suis toujours dans la plus intense certitude d’être un arbre, vivant par le globe de verdure de mon cerveau et les racines de mes membres qui relient les choses de l’éther aux choses de la Terre. Magicien comme lui, je remue dans mon immobilité, par les fleurs qui courent sur mes branches, par ma tension vers les souffles de vie. Engagé dans le sol par la force de mes succions, engagé dans le ciel par la force du jet de mon tronc, mes feuilles tâtent le bleu de l’air et sont des actes : lorsqu’elles tombent, elles m’entourent des certitudes du cosmos — lorsqu’elles se déplient, printanières, ce sont mes veines qui, une à une, reprennent leurs battements, vertes et poissantes.
***
Si mon amitié est faite avec les choses de la lumière, elle l’est aussi avec les choses nocturnes. Les étendues étincelantes, les formes à couleurs, trempent dans les reflets des ténèbres, comme les ténèbres remuent aussi dans le commencement des temps : ne suis-je pas toujours à la lisière de la nuit des temps, larve en état de genèse ? Si un arbre au Soleil projette son ombre, l’ombre est entortillée dans son feuillage lumineux. Tout à l’heure, après le couchant, l’arbre deviendra ombre parmi les ombres dans lesquelles il sera résorbé. L’être que je suis est traduit de la nuit, du plus épais de l’ombre, comme chaque chose, car la nuit n’est que l’ombre du Soleil, et de l’un à l’autre je voyage, les yeux ouverts, comme la navette entre les fils des trames. Si la nuit fonce au dedans de mes rétines, elle m’entre également par la nuque ou les épaules. Je vois par la tactile peau qui revêt mes doigts, phalange par phalange, et je ne savoure pas les succulences seulement par la gourmandise de ma bouche. Les étoiles se déposent dans mon corps comme ces cailloux lisses qui bougent en ronds d’or dans un ruisseau furtif, et je sens la réception bleue de leurs feux, au travers de mes artères qui les thésaurisent.
Ma chair, de part en part, est acceptante des multiples influx du monde, et le monde est poreux aux passages et aux glissements de mes sens qui filtrent dans cette transparence d’eau.
***
L’essieu de la Terre glisse sur ses huiles soyeuses avec la douceur de ma respiration, et les figures de la Terre respirent dans ma main ouverte et fermée sur elles, comme sur un oiseau apprivoisé. Les arêtes vives que font les candélabres des mélèzes dans le vent, sont les formes secrets de mon génie, que chaque mélèze se procrée à lui-même dans son rêve de croissance.
Article suivant — Un langage rond comme la Terre